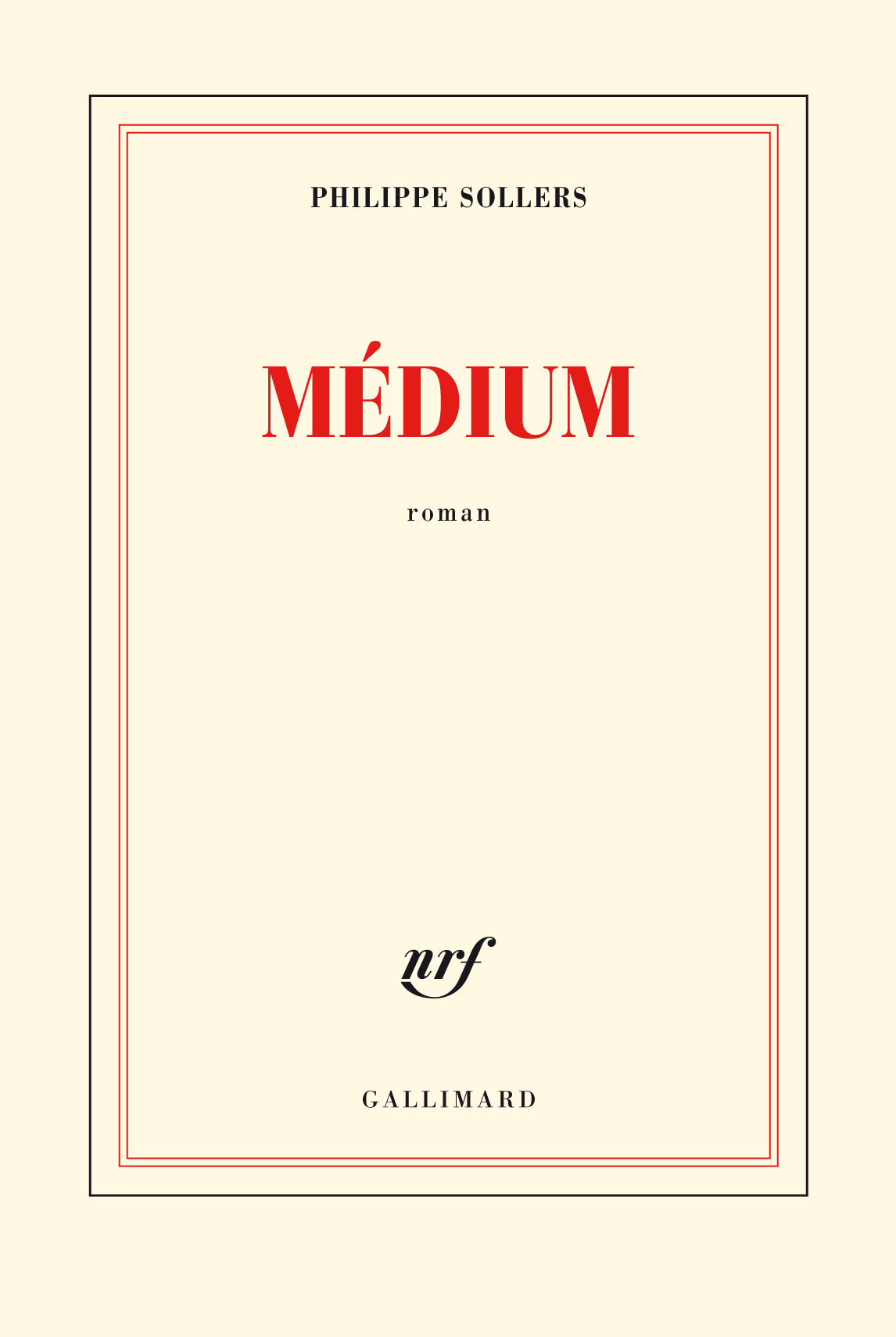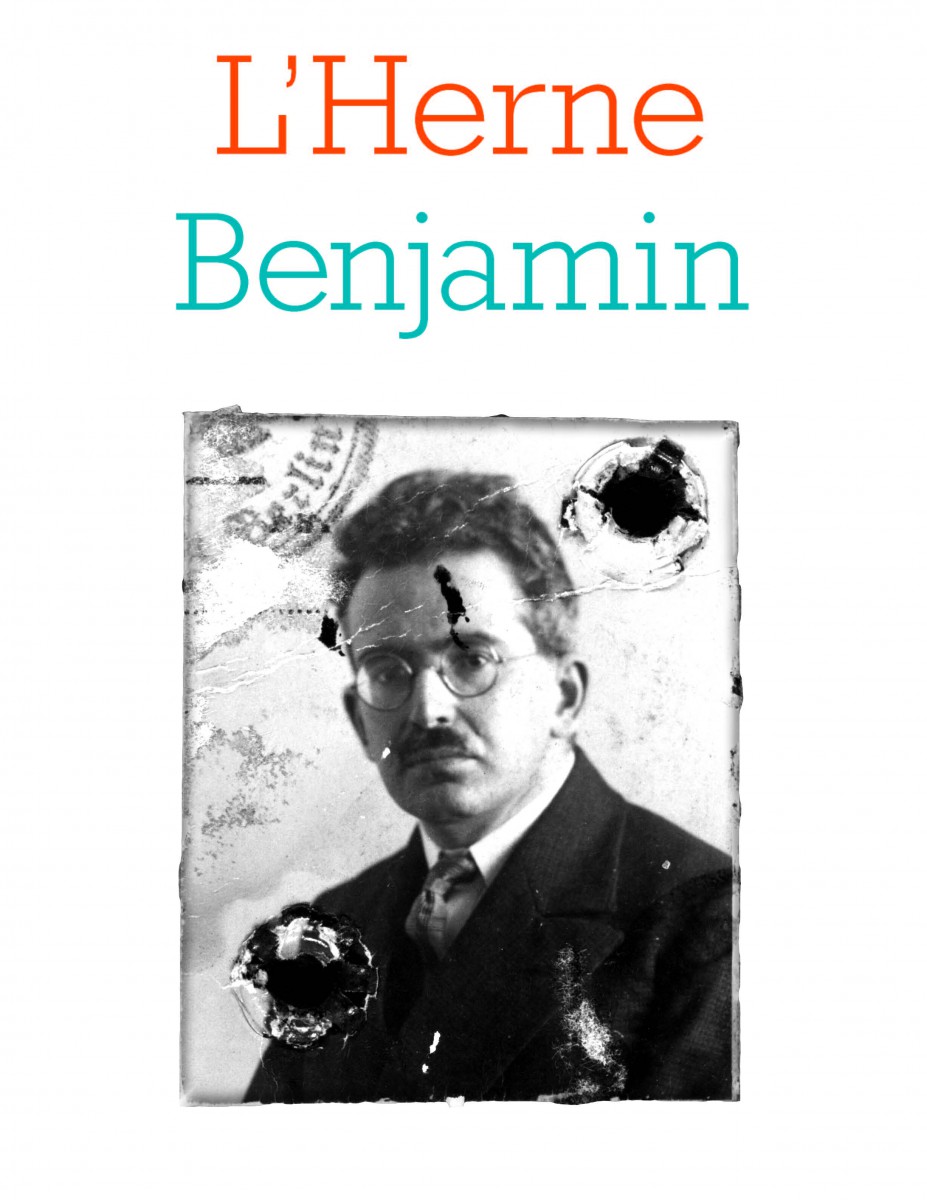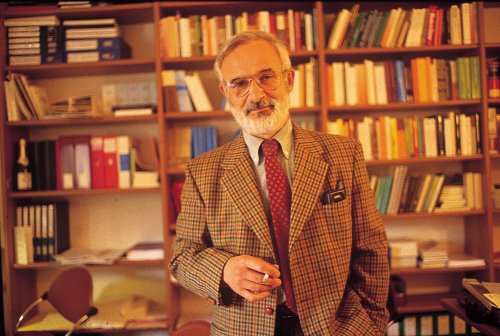Dans Médium, son nouveau roman, pour lequel La Règle du Jeu va bientôt le recevoir, Philippe Sollers écrit : «La vraie révolution, aujourd’hui, c’est de ne pas désespérer, mais d’aimer, de croire et de s’évader». On peut sourire de ce programme. On peut, si l’on a l’esprit façonné par la militance, juger ses ambitions minimalistes, déplorer son infra-politisme. Mais voilà : Sollers, c’est son audace, revisite, le temps d’une escapade vénitienne, l’hésitation entre l’esthétique et l’éthique, l’art et l’engagement. Ou, si l’on préfère : l’hésitation entre le temps suspendu de la « durée pure » (aimer, croire, s’évader…) et l’effort pour changer le monde.
Et ce débat, ce tiraillement qui a mû tout le XXe siècle dans l’impatience puis l’assèchement de ses avant-gardes – ce dilemme, donc, qui rebondit aujourd’hui sous la plume de notre Casanova national, a été, avant lui, pris en charge par un penseur allemand qui s’éprouvait à gauche et même à l’extrême gauche, Walter Benjamin (1892-1940), comme en témoigne le passionnant Cahier de l’Herne qui lui est consacré.
La continuité de l’Histoire, l’origine de la servitude
Or, si Walter Benjamin est sans doute plus actuel que jamais c’est qu’il nous offre, enfin !, de rompre avec l’illusoire narratif progressiste, sans céder à la résignation réactionnaire.
Rompre avec le progressisme ? Eh oui… Lui, le plus parisien des juifs berlinois ne s’est pas montré un lecteur assidu de Bergson et de Proust par la seule grâce de sa francophilie. Son enthousiasme pour ces deux écrivains de la « durée pure » recèle une cohérence philosophique. Chez ces devanciers, Benjamin a trouvé les ressources pour une repensée du temps. Repensée, au sens propre, émancipatrice.
Voici la première « thèse » de cette brève présentation : nous autres, modernes, que nous défendions l’auto-organisation de la société par le marché et la libre concurrence, ou que nous lui préférions la mise en commun des moyens de production, que nous soyons tocquevilliens ou marxistes, nous ne sortons jamais d’une prison mentale, nous ne sortons jamais de ce que le philosophe brésilien Michaël Löwy nomme, dans son dernier livre, « l’enserrement » : nous ne cessons jamais de nous figurer la temporalité comme une avancée linéaire et homogène, et nous tenons l’histoire des hommes pour celle d’un seul homme qui vieillit.
Telle est l’essence de ce que Benjamin nommait le « progressisme » : il ne s’agit pas de l’effort, indispensable et légitime, pour améliorer le sort des hommes et pour soulager leur condition, mais, déplore l’auteur des Thèses sur le concept d’histoire, du postulat selon lequel l’Histoire est orientée, vectorisée par une nécessité d’airain.
« Aujourd’hui encore, le récit des racines, de la filiation, de l’élection originelle revient en force dans le temps de l’histoire, menaçant de refermer la porte étroite par où le possible pourrait faire irruption et interrompre la course à la catastrophe », écrivait, peu avant sa mort, le philosophe trotskyste Daniel Bensaïd, auteur d’un beau livre sur la pensée de Benjamin (Sentinelle messianique). Bien plus « centriste » que le communiste Bensaïd, l’héritier actuel de l’Ecole de Francfort, le philosophe Jürgen Habermas, théoricien du désenclavement de l’identité allemande par l’utopie européenne, ne lit pas autrement Benjamin ; il souligne pourquoi le progressisme, c’est-à-dire la foi dans la continuité historique, forme une aliénation, pire : une accoutumance à l’injustifiable. « Pour Benjamin, analyse Habermas, la continuité historique réside dans la permanence de l’insupportable ; le progrès est l’éternel retour de la catastrophe : « Le concept de progrès doit être refondé sur l’idée de catastrophe », note Benjamin dans Zentralpark, et « que cela puisse continuer comme ça, voilà la catastrophe » ». C’est pourquoi, ajoute Habermas, « l’idée d’un présent où le temps s’arrête et devient immobile est l’une des plus anciennes intuitions de Benjamin ». Les Thèses sur le concept d’histoire déploient cette intuition : « L’histoire est l’objet d’une construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais forme une temporalité pleine d' »à-présent », surgi de la continuité historique ». Interrompre la course à la catastrophe, mettre en arrêt le continuum aliénant de l’Histoire, ouvrir cette temporalité « pleine d' »à-présent », cela signifie « défataliser » le devenir, le rendre à son imprévisibilité, le soustraire à la répétition aliénée de l’origine, de son emprise mythique et du récit de filiation, matrice des passions identitaires criminelles.
Antiprogressisme et « tikkoun »
On se souvient du bon mot du poète René de Obaldia : « Arrêtez le progrès, je veux descendre ! ». « Witz » entièrement benjaminien : la gauche radicale et communiste où se reconnaissait Walter Benjamin et dans le sillage de laquelle se situent souvent ses héritiers (notamment les intellectuels sud-américains, comme Michaël Löwy par exemple) constitue une anomalie dans la galaxie des théoriciens anticapitalistes. Une anomalie précieuse. Voici, donc, la deuxième thèse de cet article : contrairement à la social-démocratie ou à son adversaire marxiste léniniste, la gauche benjaminienne ne croit pas qu’on échappe à la « cage d’acier » (stählernes Gehäuse) du capitalisme, comme la nommait Max Weber, en dévalant la pente de la fatalité historique. Non. La gauche benjaminienne parie sur le seul geste de « saisir le frein d’urgence ».
Saisir le frein d’urgence ? Classiquement le parti du Mouvement, dans ses variantes rivales et ses scissions mimétiques, veut prendre l’ennemi bourgeois de vitesse ; le stratège benjaminien prescrit, lui, de ralentir, de baisser la cadence, de couper les moteurs. Il supplie, avec Obaldia, qu’on le laisse descendre du « grand 8″… Comment s’explique cette bizarrerie programmatique ?
Par la conception messianique du temps qui traverse la pensée de Benjamin, répond son ami Gershom Scholem. « Nager à contre-courant de l’Histoire », pour Benjamin, avertit celui qui l’a initié à la Kabbale et à la mystique juive, c’est non seulement refuser les verdicts iniques de l’Histoire en majesté, c’est non seulement défataliser le temps, mais c’est surtout se faire le témoin et le messager des générations passées – c’est, en un mot, devenir le porte-voix de leurs espérances, de leurs rêves éveillés d’affranchissement, de leurs volontés d’émancipation.
Comment comprendre cette vocation ? Dans une longue lettre à Scholem, datée du 12 juin 1938, c’est-à-dire d’un moment de l’histoire européenne où se dessine déjà clairement l’ampleur du désastre nazi, Benjamin livre un début de piste : « L’œuvre de Kafka est une ellipse, dont les foyers extrêmement écartés sont déterminés, l’un par l’expérience mystique (qui est avant tout expérience de la tradition), l’autre par l’expérience de la grande ville moderne ». Et il ajoute : « Le monde de Kafka, souvent si serein et traversé par des anges, est l’exact complément de son époque qui s’apprête à supprimer par masses entières les habitants de cette planète. » La bifurcation salvatrice, le pas-de-côté par rapport à une Histoire devenue homicide suppose le recours à la tradition – mais pas la tradition des traditionalistes, plutôt la tradition entendue dans un horizon messianique, celui que cherche l’œuvre de Kafka. Tel est le sens d’une phrase importante de Benjamin, souvent mal comprise, et contemporaine du même moment de pensée : « Le passé a barre sur nous, nul ne peut échapper à sa sommation ». Nul passéisme dans cette obéissance au passé. Face au péril extrême, « une faible force messianique » est accordée à ceux qui tentent de renouer le fil perdu de la tradition ; le futur peut être soustrait à la barbarie qu’annonce Kafka, si les utopies échues sont réanimées ; une « nouvelle ère historique » peut encore être initiée, si le temps s’entrebâille à la dimension de l’éternité et si l’humanité menacée accomplit la « destitution de l’emprise mythique ».
Mysticisme de Benjamin ? En fait, pas du tout. Plus que vers un néoconservatisme religieux, c’est vers un surcroît de responsabilité que tend donc, au soir de sa vie, la pensée du plus baudelairien des penseurs allemands.
Scholem, dans son essai Walter Benjamin et son ange, note à raison que l’idée du tikkoun olam, de « réparation du monde », est à l’œuvre dans la pensée de Benjamin. A la lumière du tikkoun les objectifs de la Révolution changent : il ne s’agit plus de substituer la religion de la production communiste à la religion de la production capitaliste, mais de recoudre la continuité du monde lacérée par un Progrès immaîtrisé. Cet « arrêt messianique », Heinz Wismann l’assure dans le Cahier de l’Herne, ne serait rien d’autre que la quête du bonheur. Qui sait, en effet…
Changer la vie ? Walter Benjamin , l’Amérique Latine et l’histoire « brossée à rebrousse-poil »
Comment s’évader de l’enserrement planétaire du capitalisme mondialisé ? Comment « migrer » (c’est le mot de Benjamin) hors de son habitacle destinal ?
En marge du consensus de Washington, et malgré la large conversion des gauches européennes à l’historicisme néolibéral, cette question rebondit, aujourd’hui, dans le débat intellectuel d’un certain nombre d’ « émergents » sud-américains, comme en témoigne Löwy, et sa Cage d’acier (Stock).
Löwy exhume des papiers inédits de Benjamin publiés par Ralph Tiedemann et Hermann Schweppenhäuser, un texte « obscur », mais, ajoute-t-il, « d’une grande actualité » : « Le capitalisme comme religion ». Trois à quatre pages de notes et de références bibliographiques dans lesquelles on peut lire ceci : « Il faut voir dans le capitalisme une religion ». Et son auteur d’ajouter, en s’éloignant passablement de Max Weber, et de son Ethique protestante et l’esprit du capitalisme : « Le capitalisme s’est développé en Occident comme un parasite sur le christianisme (…) de telle sorte qu’en fin de compte, l’histoire du christianisme est essentiellement celle de son parasite, le capitalisme. Ce que le capitalisme a d’historiquement inouï tient à ce que la religion n’est plus réforme mais ruine de l’être ». Enfin, précise
Benjamin, citant Nietzsche, nous assistons « à la transition de la planète homme, suivant son orbite absolument solitaire, dans la maison du désespoir ».
Et pourtant, estime Löwy, il est encore possible de fuir la « maison du désespoir ». Dans un autre texte, l’intellectuel brésilien constate : « L’historicisme s’identifie empathiquement (Einfühlung) aux classes dominantes. Il voit l’histoire comme une succession glorieuse de hauts faits politiques et militaires. En faisant l’éloge des puissants et en leur rendant hommage, il leur confère le statut d’héritiers de l’histoire passée. En d’autres termes, il participe – comme ces personnages qui élèvent la couronne de lauriers au-dessus de la tête du vainqueur – à « ce cortège triomphal où les maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps des vaincus » (Thèse VII). Le butin qu’on porte dans ce cortège est ce qu’on appelle les « biens culturels ». Il ne faut pas oublier, souligne Benjamin, l’origine de ces biens : « chaque témoignage de culture est en même temps un témoignage de barbarie » (Thèse VII). Ainsi les pyramides d’Égypte, construites par les esclaves hébreux, ou le Palais de Cortez à Cuernavaca, par les indiens asservis. Les luttes de libération du présent, insiste Benjamin (Thèse XII) s’inspirent dans le sacrifice des générations vaincues, dans la mémoire des martyrs du passé ». Et Löwy poursuit : « Traduisons cela en termes de l’histoire moderne de l’Amérique Latine : la mémoire de Cuhahutemoc, Tupac Amaru, Zumbi dos Palmares, José Marti, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Marti ». 2014 s’annonce une année marquée par ce Derrida appelait « l’indécidable ». L’urgence à « changer la vie » et à scier les barreaux de la cage d’acier a produit, dans le Venezuela de Chavez, et même dans la Bolivie de Morales, des contre-révolutions populistes, abusivement siglées « de gauche ».
En attendant, la « tradition des vaincus » trace sans doute « une perspective « par en bas » », comme la nomme Löwy, et cette perspective investit tous les champs de la science sociale avant peut-être de trouver un jour prochain sa traduction politique, dans l’une des démocraties d’Amérique Latine. A suivre…