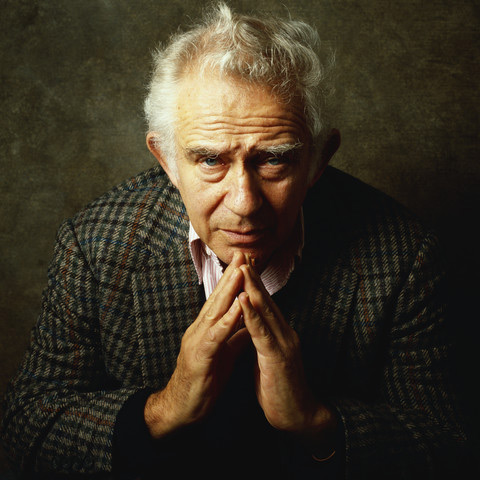La Comédie Humaine du XXIème siècle, ce roman total, profond, panoptique des villes contemporaines, l’encyclopédie de l’argent et des ambitions du temps présent, cette œuvre d’une incroyable vérité car chacun de ses personnages est vu tantôt comme héros, tantôt comme silhouette d’un autre drame, ce roman-là, il n’a pas été encore écrit, ni publié : il a été filmé, diffusé par HBO, de 2002 à 2009, il s’appelle The Wire, et c’est, sans aucun doute, la meilleure série télévisée de tous les temps.
Deux choses, pour commencer. D’abord, la mode des « séries », ces douze épisodes d’un quelconque drame avec dragons et chevaliers ou mafieux dépressifs qui, au fur et à mesure de l’intrigue, avalent vos amis, vos loisirs, et tous vos lundis soirs, cette tendance à trouver formidable n’importe quel feuilleton tellement original, sensationnel, brûlant, venus d’une chaîne américaine, anglaise ou danoise, avec des costumes très chers et des acteurs impeccables, toute cette passion pour les séries : magazines branchés, critiques sérieuses et pénétrées dans les pages chic des journaux (la sériphilie devenant le critère discriminant pour repérer qui est un vieux dinosaure resté au XXème siècle ou un honnête homme moderne, épanoui et connecté), cette folie des séries est disons-le, assez insupportable. Certaines, sont en effet, formidables, d’autres un peu moins. Game of Thrones, par exemple, restera, à mon avis, comme le Star Trek de notre génération, une oeuvre plutôt novatrice et agréable, mais dont il faut être bien myope pour ne pas repérer le grotesque façon elfes en costumes, le côté très premier degré, sans aucun humour, cet univers codé, clos et abscons, toutes choses qui la vouent très probablement à passer de mode, devenir, avec du recul, le spectacle étrange de notre égarement juvénile, puis à faire rire nos enfants pendant de très longues années.
Ensuite, on ne manquera pas de m’objecter, en préambule, que faire l’éloge de The Wire bien après des personnalités aussi éminentes que Barack Obama ou Mario Vargas Llosa (« The Wire possède la densité, la diversité, l’ambition et le lot de surprises et d’incertitudes, que seuls possèdent les bons romans, qui semblent reproduire la vie elle-même, et que je n’ai jamais vus auparavant dans une série télévisée, que caractérisent souvent le superficiel et le schématique » 1 ), oui, arriver après les derniers coups de feu, tresser des lauriers aux gloires sans conteste, rendre hommage à l’avant-garde devenue institution, démontrer la beauté, l’intelligence et la profondeur d’une série, passée depuis longtemps, de colloques en essais, de la Sorbonne à Harvard, cela n’a aucun sens, aucun mérite. C’est vrai. Mais qui vous dit que je ne vais pas le faire d’une manière spécialement neuve et intéressante ? Qui vous dit que cet article n’apportera pas sa pierre, certes modeste, mais enfin déterminante à l’édifice des théories en cours ? Comment pouvez-vous en êtes si sûr ? Vous avez, ci après, un article plein de choses nouvelles et édifiantes, souvent fascinantes. Allons, lisez-le donc, vous ne le regretterez pas. Comme on dit chez HBO : quel beau teaser, n’est-ce pas ?
The Wire (Sur Ecoute, en français), c’est une série créée par la chaîne HBO (Home Box Office, autrement dit, « le cinéma chez soi »), et surtout inventée, écrite et produite par Ed Burns, un ancien policier, et David Simons, un ex-journaliste du Sun. Nous sommes à Baltimore, ville sinistre et sinistrée de la côte Est ; dans les rues, les maisons de brique rouge sont le théâtre des trafics de drogue ; sous un ciel bleu pâle et tremblotant, des quais de la ville, grevés de containers, de dockers polonais et de beuveries trop joyeuses, jusqu’aux parkings immobiles où chacun vient acheter sa dose de rêves en sachets et d’orients en poudre, la police patrouille, enquête, interroge, s’arrête devant les fast-food, regarde les témoins de meurtre se faire à leur tour descendre, les enfants vont à l’école en pensant aux dollars sales des arrière-cour tenus par leurs grands frères, les journalistes questionnent mollement le procureur, on se défonce dans des caves hideuses, l’herbe verte pousse entre les dalles disjointes des rues, la communauté noire fait monter les enchères au parti démocrate, les cadors de la coke se font assassiner par leurs rivaux depuis leur cellule bleue, les profs n’ont pas de moyens, les Grecs nous livrent la dope demain soir près des docks, tiens écoute ça, Bunk, j’ai un mandant d’arrêt mais sa mère ne dit pas où se trouve le suspect, on écoute du rap flamboyant dans des voitures sournoisement arrêtées dans une nuit solitaire, le lieutenant de police charrie ses adjoints en découpant leurs cravates quand ils s’endorment sur leur rapport, les avocats ont des costumes en cachemire trop élégants et des bas-joues trop rebondies, on enterre les morts en buvant du whisky à s’en rendre malade et fou, c’est la crise, c’est l’Amérique des années Bush, c’est la vie comme dans un roman. Il n’y a pas vraiment de héros, tous les méchants sont effroyablement sympathiques, mais se déploie devant nous un spectacle unique en cinq saisons, celui d’une comédie humaine dont le centre est partout et la circonférence nulle part, englobant les mondes et les territoires, l’univers des policiers et celui des dealers, s’arrêtant, pour un épisode, dix minutes ou trente secondes, sur le destin d’un enfant, d’un camé perdu dans les rues, d’un sénateur corrompu ou d’une salle de classes angoissée par les coupes budgétaires, c’est Baltimore saisi par tranches, bribes et plans séquences, une ville dont le fouillis des rues se dédouble d’un écheveau d’intrigues et de complots.
Néanmoins, la première saison ne manquera pas de rebuter le spectateur le mieux intentionné car The Wire tranche sur toutes les autres séries, certes par la beauté formelle d’une image nette et froide, imprimant les visages afros ou irlandais sur des fonds immenses et nuageux ou dans l’enchevêtrement d’une nuit de fusillade et de colts 45, mais aussi, au-delà d’une science des cadres et un art de l’éclairage proprement divins, par des partis pris terriblement exigeants : pas de musique, pas de rebondissements, une étude à la limite de la sociologie façon observation participante. Pourtant, il faut faire l’effort de passer ces premiers épisodes, fascinants mais étrangement froids, l’orgueil impénétrable de l’oeuvre étant le reflet d’une profondeur que l’on commence à soupçonner, mais qui laisse au début étranger, car, comme chez Balzac, dans ses premières pages, depuis l’imprimerie des Séchard dans les Illusions Perdues jusqu’à la sociologie minutieuse de la ville de Saumur dans Eugénie Grandet, les préambules sont certes longs, mais inévitables. Ce n’est pas la machinerie d’un suspense, qui, patiemment est en train de se tricoter au fil des épisodes, ce n’est pas l’acclimatation aux personnages que l’intrigue propose durant les premières heures. S’il faut d’abord patienter, s’ennuyer, apprendre et être attentif, puisque chaque saison creuse le sillon de la précédente, c’est parce que chaque personnage se découpe sur un fond détaillé d’anecdotes préalables, chaque intrigue émerge d’un humus stratifié par les rebondissements précédents, donnant, à l’image, au bout de quelques heures, une troisième dimension aux personnages de The Wire, une épaisseur subjective, fulgurante et authentique, celle de la mémoire et du temps écoulé. Ainsi, comme chez Balzac, The Wire propose un univers total et romanesque, dont les premiers feux, lorsque l’on y pénètre sont l’aiguillon de la curiosité et du mystère. Comme dans la Comédie Humaine, il s’agit bien de faire « concurrence à l’état civil », en déployant, en cinq saisons et grâce à des acteurs tous éblouissants de justesse, le portrait de deux cent personnages, flics, magistrats, maire, journalistes, profs et dealers. Comme dans l’œuvre balzacienne, les auteurs veulent montrer les « effets sociaux » (la pauvreté, la défonce à même le sol), puis les « causes » (les passions humaines, comme l’ambition de Stringer Bell, malfrat venu des quartiers ouest, s’achetant des cravates larges pour jouer au promoteur respectable, avec déjeuner et notes de frais, trahissant son clan et sombrant, malgré tout), et enfin les principes (le vice intrinsèque de l’état social des années Bush, que dessine, au final, la série). Comme chez Balzac, dont Baudelaire disait que « tous ses personnages sont doués de l’ardeur vitale dont il était animé lui-même » et donc qu’en somme, « chacun dans Balzac, même les portières, a du génie », on s’attache inévitablement au moindre enfant, sous-divisionnaire de police, ou dealer, tel le légendaire Omar Little, a priori simple frappe, mais, au fil des aventures, paladin flamboyant des bas-fonds, Robin des Bois du sachet de coke détroussant les dealers et protégeant les égarés, aventurier génial et sarcastique des labyrinthes sous méthamphétamines. Comme la Comédie humaine, encore, qui, selon la belle phrase de Mauriac, est « un rond-point » d’où « partent les avenues que Balzac a tracé dans sa forêt d’hommes », le Baltimore de The Wire est une ville en forme de pandémonium, dont on ne peut apprécier les personnages qu’en les ayant fréquentés, alternativement sur le devant de la scène ou en bord de cadre, au premier plan ou en filigrane, dans l’action ou les confessions. Ainsi, le personnage principal, McNulty, policier alcoolique et priapique, disparaît pendant une saison, quand le vrai méchant, Marlo, enfant au visage d’écolier attentif, en mettra trois, pour émerger et devenir comme l’ange noire des ruelles, venelles et sentiers froids de Baltimore. Autant dire que les personnages de la série vous seront d’abord inconnus puis familiers, antipathiques à votre esprit et soudain indispensables au souffle de votre cœur, insignifiants et d’un coup proéminent, tout comme, chez Balzac, dans les débuts, Bianchon est un fantôme, Montriveau un cavalier de bal anonyme, Diane de Maufrigneuse une duchesse parmi d’autres, alors que, chacun d’entre eux, plus tard, sera le héros d’un roman, d’un chapitre, que nous apprendrons tout, de leur biographie sentimentale et de leur destin, au Faubourg Saint-Germain ou dans les villes de province. C’est pourquoi, si, bien entendu, ce que Proust appelait « l’éclairage rétrospectif des personnages » ne s’applique, dans le roman, jamais mieux qu’à Balzac, dans les séries, c’est bien The Wire qui possède en propre cette science d’avancer un protagoniste, l’animer, le retirer, le retourner en son envers obscur, expliquer soudain son passé, dévoiler un continent de sa vie pour aussitôt l’oublier, l’escamoter ou le placer dans un coin, comme un détonateur d’intrigue, au service des épisodes ultérieurs dont il sera l’incendie ou le démiurge.
Dans The Wire, la dernière des cinq saisons est l’une des plus saisissantes, avec, toutefois, la deuxième, une extraordinaire étude de la vie des dockers digne des plus grands romans, avec son héros Frank Sobotka, un syndicaliste mélancolique et bourru ouvrant les portes des containers aux mafieux, non pour s’enrichir, mais pour inonder avec l’argent de la drogue ses frères de lutte, de grue et de nuits à la bière. Dans l’ultime saison, l’austérité narrative du début a fait place à un rythme plus explosif, plus drôle, aussi, extraordinairement brillant, enfin, dans l’écriture, comme lorsque, dans une seule scène, celle où Clay Davis, potentat démocrate local, use, au tribunal de ses origines Afro-Américaines pour arracher son innocence malgré ses activités sulfureuses par un discours où il invoque le mode de vie de « son peuple », le spectateur comprend en quelques phrases tout, de l’Amérique, des Noirs, de la vie, grâce à cette mise en scène de la dialectique complexe entre injustices monstrueuses, ségrégation raciale, exploitation politicienne, fierté communautaire, roublardise des hommes publics, et effets pervers d’une justice pourtant démocratique. La dernière des cinq saisons, donc, est peut-être encore plus éminemment balzacienne, puisqu’elle voit s’affronter, se côtoyer et s’éloigner les deux héros, tiraillés entre la droiture et la folie, chacun d’entre eux semblant tout droit sorti du cerveau de l’amant de Madame Hanska. Ainsi, Jimmy McNulty, le policier génial et incontrôlable, véritable Rubembré de la East Cost, d‘abord idéaliste puis peu à peu, quittant l’orbite de ses convictions pour sombrer, par désir de justice, dans les manigances les plus absurdes, puis, après son plus grand succès, revenir à l’état social qu’il avait au départ. Comme Rubempré, son idéal dégénère inexorablement en monomanie, et la reconnaissance cherchée s’éloignera sans cesse comme un leurre qu’on retrousse. De l’autre côté, Tommy Carcetti, simple conseiller municipal devenu en trois saisons gouverneur du Maryland, Rastignac démocrate, politicien absolument attachant mais dont l’ambition le pousse à retomber dans les travers municipaux qu’il dénonçait en campagne : comme son double balzacien, il réussit par le charme, et l’assurance des habiles, même si, chez lui, au moins, les convictions servent sinon de prétexte, du moins de nécessité intérieure. McNulty contre Carcetti, ce n’est pas un portrait simple et dual, l’homme pur qui échoue contre l’étoile cynique qui s’élève, c’est un « envers de l’histoire contemporaine » en clair-obscur, constellant ces deux hommes de mille nuances, de millions de sfumatos, rendant ces deux personnages de fiction infiniment vrais, comme le sont chacun des soldats minutieux de cette intrigue gigantesque, du rédacteur du Sun, vieux routard ironique, à Bunk, le flic obèse aux yeux d’enfant, tous les passants magnifiques et misérables de ce « carrefour », comme le disait, encore, Alain à propos de l’œuvre de Balzac. Roman total, roman des hommes face à l’ambition, le pouvoir et le désir, roman de la drogue et des vices modernes, roman, surtout, de l’argent, celui des rappeurs, façon champagne, cannabis et voitures hardies, et celui des puissants, l’argent des déjeuners de sénateurs et l’argent des gouverneurs impécunieux, l’argent des humbles, des profs mal payés et du whisky bourreau des couples, l’argent des gosses rabatteurs à douze ans et assassins à treize, l’argent des heures sup de la police pour ramasser les douilles au croisement des artères de la dope, roman de l’argent des passeurs et des camés, roman du port et des cités, The Wire est enfin le roman d’une ville. Car du Paris de Rubempré au Baltimore de McNulty, les mots, cette fois-ci, sont exactement les mêmes : « cette ville n’est-elle pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d’intérêts sous laquelle tourbillonne une moisson d’hommes que la mort fauche plus souvent qu’ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l’esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux ; non pas des visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d’hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une haletante avidité ? Que veulent-ils ? De l’or, ou du plaisir ? » 2
1Mario Vargas Llosa, « Les Dieux Indifférents, », tribune à propos de The Wire parue dans El Pais du 11/10/2012.
2 Honoré de Balzac, in « La Fille aux yeux d’or », première phrase.