Pour la deuxième année, Paris est, en ce début de novembre, la capitale européenne du marché de l’art ancien.
Sous le plafond doré du palais Brongniart, place de la Bourse, les grandes galeries d’art ancien exposent – et vendent – leurs plus belles pièces à l’occasion du Salon Paris-Tableau.
Alors que les medias n’ont d’yeux que pour la création contemporaine, face à laquelle le public, passablement désemparé, se demande quelle comédie à huis-clos se joue là entre artistes-financiers et acheteurs-spéculateurs, s’interrogeant face à des requins dans le formol atteignant des millions d’euros ou des homards gonflables décorant les salons de Versailles, une autre voie existe, où se retrouvent collectionneurs, connaisseurs ou simples amateurs venus admirer les dernières trouvailles des galeristes européens.
Tout en discrétion, en rien tape à l’œil, comme un de ces petits tableaux d’intérieur hollandais – beaucoup sont exposés ici, le monde de la peinture ancienne (comprenez antérieure à 1850), loin des feux de la rampe, aux antipodes de la FIAC ou de la Biennale des Antiquaires, se retrouve « entre soi » à la Bourse. Ce n’est certes pas l’art pour l’art. Le but est de vendre. Mais on ne se sent pas dans une super foire mondialisée pour millionnaires frais débarqués de leurs jets privés ou dans une salle de vente londonienne. On y croise plutôt de vieux académiciens dix-septièmistes, des conservateurs de musée qui lorgnent le chef-d’œuvre « abordable », plus quelques dames élégantes qui font courageusement, avant de passer à l’examen des œuvres, honneur aux plateaux de champagne, histoire de se mettre les yeux et l’esprit en appétit.
Mais venons-en aux tableaux.
Encore de la peinture ancienne, direz-vous, la même qu’au Louvre, la même qu’à la National Gallery, la même qu’au Prado, la même que dans tous les musées du monde. Une peinture de musée. Du connu, rien de nouveau à l’horizon.
Vous vous trompez. Paris-Tableau est la preuve du contraire. C’est certes un univers familier qui s’égrène sur les cimaises des galeries. Des Hollandais et des Flamands du XVIIe siècle, de la grande peinture caravagesque italienne, l’aimable rococo français des temps de Louis XV, de petits paysages du début du XIXe siècle. Mais il y a cela de plus par rapport aux musées dont les collections sont examinées, exposées, publiées, répertoriées, que ce sont ici des œuvres quasi-inconnues, voire totalement inédites ou restées en mains privées depuis si longtemps qu’on en ignorait l’existence, sinon, pour quelques-unes, par reproduction ou pour avoir figuré une fois ou deux dans telles expositions jadis, à Edimbourg, Dresde, Gênes ou Vicence. Cette peinture qu’on appelle ancienne est en réalité bien vivante, et on se rend compte à parcourir l’immense salle du palais de la Bourse qu’elle est loin d’être condamnée aux cimaises des musées, qui l’éternisent mais jettent sur elle un voile immobile, voire la recouvrent d’un rideau de poussière…
Car ici, l’excitation est au rendez-vous. Ces œuvres là, et quelles œuvres!, sont vivantes et, d’autant plus pourrait-on dire, qu’elles sont à vendre. On peut, le Salon achevé, repartir avec un tableau de la Renaissance sous le bras. Pas moi hélas. Peut-être pas vous. Mais, dans l’absolu, c’est possible. Pierre Rosenberg, académicien et ancien directeur du Louvre, a dit un jour qu’un musée qui n’achète pas est un musée qui meurt. De même, une peinture qui ne s’achète pas est une peinture qui meurt. Et le verdict est que la peinture ancienne est loin d’être morte. Alors que l’on a l’image (fausse) que tout est déjà dans les musées, pas de croûtes à Paris Tableau, pas de fonds de tiroir. On n’a nullement le sentiment d’arriver après la bataille, de n’avoir droit qu’à des miettes, qu’auraient dédaigné les institutions muséales. Certes, vous ne trouverez pas de Rembrandt ou de Caravage, mais le nom ne fait pas tout (notez qu’un portrait de Goya est proposé par la galerie Caylus ; pas des meilleurs, il est vrai), et la moisson est conséquente et la qualité au rendez-vous.
Outre qu’il y a encore de l’aventure à vivre, des tableaux dont il faut reconstituer l’historique, des attributions à faire ou à défaire, des toiles anonymes en quête d’auteur.
Bref, au vu des œuvres proposées, la peinture dite ancienne a encore de beaux jours devant elle.
Alors, si de rares privilégiés pourront demain accrocher la toile qui les aura séduit dans leur salon, pour nous autres, amants de l’art et de l’aventure, allons toucher avec les yeux ces œuvres qui regagneront dans quelques jours la confidentialité des galeries et des collections privées.
Guidés par le plaisir des yeux et au hasard des galeries, passant d’une salle à l’autre de cet éphémère musée, sans programme à l’avance, laissons-nous porter à travers les âges et les pays pour un tour d’Europe de la peinture ancienne.
Puisqu’il faut bien jeter son sac quelque part, choisissons l’Italie, berceau de la peinture occidentale. Et faisons le chemin à l’envers, commençons par la fin, commençons par le XVIIIe siècle, essentiellement vénitien.

Des Canaletto, des capricci de Guardi à la touche si vibrante qu’on voudrait les croquer (galerie Cesare Lampronti), une vue du Colisée de Rome envahie par les herbes et les chèvres par Bernardo Bellotto, ou encore deux admirables ruines en clair-obscur de Coccorante, vous donnent l’impression de vous trouver dans un palais italien du XVIIIe siècle. Le sombre XVIIe siècle, éclairé par la chandelle des caravagistes, est également présent. Un beau trio de musiciens par Nicolas Tournier, Toulousain formé à Rome, s’admire à la galerie Jacques Leegenhoek. On relèvera avec intérêt le raccourci utilisé par le peintre pour représenter la manche, la main ainsi que le visage du personnage central. Dans la même galerie, on remarque une Cène à Emmaüs du napolitain Filippo Vitale peinte dans une veine très ténébriste qui dénote l’influence de l’espagnol Ribera. Enfin, pour parfaire, si l’on puis dire, le tableau, un David tenant la tête de Goliath ne pouvait manquer. Il est signé Giuseppe Vermiglio et se trouve à la galerie Canesso.
La peinture de la Renaissance est moins présente. On ne s’en arrêtera que mieux devant les expressions terrifiées et les mouvements brusques et étonnamment figés des amies de Lucrèce dans le tableau de Donnino et Agnolo di Domenico del Mazziere représentant Lucrèce annonçant son suicide, exposé à la galerie G. Sarti. A gauche de la composition savamment rythmée par des arcades, vous remarquerez le geste de la main par lequel Lucius Junius Brutus, fondateur légendaire de la République romaine, en armure, chasse l’étrusque Tarquin, reconnu coupable d’avoir violé Lucrèce. Rien n’y fera. La belle Romaine, bien qu’innocente, se suicidera, ne pouvant se résoudre à survivre à pareil déshonneur.
La seule galerie d’art espagnol, la Galerie Caylus retient non moins l’attention. On peut encore en 2012 acheter un Saint-François d’Assise peint par Zurbarán ou un Murillo (La Vision de Saint Antoine de Padoue) ainsi qu’un portrait par Goya (cité plus haut) !
Les petits formats hollandais et flamands se trouvent à foison sur les cimaises du palais de la Bourse. Des natures mortes, des vanités, des scènes de genre, des patineurs sur la glace, des paysages, des portraits, tout y est. A la galerie Claude Vittet, un Allemand de la Renaissance, Hans Wertinger, nous montre, dans un style qui mêle les leçons plastiques de la Renaissance à un intérêt miniaturiste hérité du Moyen Âge, la vinification du raisin au mois d’octobre. Toutes les étapes de la vinification sont représentées avec une foule de détails très expressifs, typiques de cette école allemande si active avant que l’iconoclaste Luther ne vienne proclamer l’impiété des images et lui asséner un coup d’arrêt aussi brutal que désastreux pour l’histoire de l’art.
Chez le parisien De Jonckhere, il faut admirer un petit portrait peint sur bois par Corneille de Lyon au XVIe siècle et représentant le duc d’Etampes, d’une fraîcheur et d’une précision éclatantes.
De belles natures mortes signées Davidsz de Heem ou Van Aelst sont également là, ainsi que de jolis paysages imaginaires dans des tons bruns, verts et dorés, des patineurs sur une rivière gelée par Essaias Van de Velde ou encore un autre paysage, par Jan Bruegel l’Ancien, peuplé d’une foule de petites figures colorées. Un portrait par Jan Anthonisz. van Ravensteyn nous montre l’assurance et l’opulence qui n’étaient pas que celles du bourgmestre représenté mais de tout un pays, ces Provinces Unies du Siècle d’Or, petite république marchande et tolérante, seule de son espèce dans une Europe monarchique et absolutiste.
A tout seigneur tout honneur, la peinture française figure en très bonne place et est riche de découvertes ou redécouvertes passionnantes.
Commençons par le Grand Siècle et Jacques Linard, un maître de la nature morte inspiré par l’exemple des Flamands auquel il joint le dépouillement classique dont un Français du XVIIe siècle ne saurait se passer. Il signe une admirable petite nature morte, ce qu’il y a de plus simple dans une composition balancée, présentée par la galerie P. de Boer. D’autres belles natures mortes sont signées Pierre Dupuis et François Garnier.

Chez Didier Aaron, un portrait du cardinal de Retz par Claude Lefebvre rappelle le talent de portraitiste de cet artiste qui représenta les Grands de son siècle. On se rendra ensuite à la Koetser Gallery pour admirer un petit chef-d’œuvre signé Sébastien Stoskopff, ce peintre strasbourgeois du XVIIe siècle qui fut l’un des plus grands maîtres de la nature morte et de la vanité et dont on découvre une Vanité avec un vase de thériaque, datée de 1627. On reconnaît tout de suite le style caractéristique de l’artiste. Un fond noir uniforme, une table de pierre grise sur laquelle se détachent des objets rigoureusement disposés les uns à côté des autres, avec, ici, trônant au centre de la composition, la forme inquiétante d’un crâne placé sur un livre qu’il semble mordre de ses dents pourries, symbolisant le savoir que l’homme acquiert au cours de sa vie mais qui ne peut empêcher la mort de survenir. La pot de thériaque, un puissant antidote contre les poisons et donc un symbole de vie, est juché sur une boîte de copeaux à l’équilibre si précaire qu’elle nous rappelle que la vie ne tient qu’à un fil. Cette boîte, un motif qu’affectionnait particulièrement le peintre et que l’on retrouve souvent dans ses peintures, signifie le cercueil où finira tout homme. Vanitas vanitatum.
Chez Eric Coatalem, se trouve l’une des plus belles surprises de ce salon, une magnifique série de sept esquisses ou modelli par Jean-François de Troy (1679-1752) représentant l’histoire d’Esther et qui furent les études préparatoires de sept immenses cartons les reproduisant sur plusieurs mètres de haut et long, modèles grandeur nature d’autant d’admirables tapisseries tissées par les lissiers de la manufacture royale des Gobelins, aujourd’hui au Louvre, au Mobilier national et à la Roche-Guyon. De Troy, un artiste versatile, à la fois portraitiste, peintre de genre et d’histoire, à la touche libre et colorée, fut l’un des meilleurs représentants du style rocaille en France durant la première moitié du XVIIIe siècle. Il passa une grande partie de sa carrière à Rome, où il finit directeur de l’Académie de France. En 1736, déjà vieux, il obtint une commande de l’administration des Bâtiments du Roi pour des tapisseries sur un thème alors très prisé pour son orientalisme (c’est l’époque des Lettres persanes de Montesquieu et de la découverte des Mille et unes Nuits) et les rebondissements peu chrétiens de son intrigue biblique : l’histoire d’Esther. Les sept esquisses que l’on a sous les yeux représentent le premier stade d’un vaste projet, dont ces grandes tapisseries réalisées aux Gobelins sont l’aboutissement. De Troy soumit ces esquisses à l’approbation de l’administration royale qui lui passa ensuite commande des cartons. Ces petits tableaux rendent justice au talent virtuose et italianisant du peintre. Ce sont des œuvres à la touche vive, empâtée, frivole. Une crème rococo pour des scènes empreintes d’un pathos théâtral, d’où l’érotisme n’est pas absent…
Magnifique et unique, cette série a traversé les âges et est passée de main en main, intacte.
La galerie autrichienne Sanct Lucas présente, elle, deux marines du peintre phocéen Lacroix de Marseille, figurant respectivement l’aube et le crépuscule dans un port imaginaire d’une Italie fantasmée, peintes dans l’esprit de Vernet et baignées d’une douce lumière qui évoque à merveille les torpeurs du climat méditerranéen. Calme et volupté se font ici peinture.
Intéressons-nous enfin au XIXe siècle français, spécialité de la galerie Talabardon et Gautier, sise rue Saint-Honoré. Ici point d’impressionnistes, de pointillistes ou autres symbolistes, mais des peintres de la première moitié du siècle, à la formation académique solide et au pinceau très sûr. Le peintre italien Giuseppe Canella a représenté Paris pendant les journées de juillet 1830 : la scène se déroule devant ce même palais Brongniart où l’œuvre est aujourd’hui exposée, nous rappelant que la Bourse fut l’un des foyers de l’insurrection. On y voit une foule de personnages, des militaires et des gardes nationaux dans des uniformes dépareillés, qui s’apprêtent à marcher sur l’Hôtel de Ville sous le regard de quelques badauds et de deux ou trois dames ; des drapeaux tricolores flottent ça et là sous le soleil révolutionnaire. La silhouette du palais Royal, résidence du duc d’Orléans, le futur Louis-Philippe, monté sur le trône à la faveur de la Révolution de Juillet, se distingue dans la perspective de la rue Vivienne. Rendons-nous maintenant chez Bob Haboldt, spécialiste reconnu de la peinture nordique ancienne. Une œuvre en particulier frappe le visiteur, elle n’est pas si ancienne, elle n’est pas hollandaise ou flamande, elle date du XIXe et elle est française : il s’agit d’une étonnante et magnifique vue en perspective du Campo Santo de Pise du jusqu’ici inconnu Antoine-Marie Perrot. La perspective est vertigineuse, les couleurs vives, on a l’impression d’y être, un pas de plus et on entrerait dans le tableau. Non loin, chez Jean-François Heim, on trouve un impeccable portrait d’esclave nègre par Gérôme, le pape de ces peintres que l’on appellera hâtivement et dédaigneusement pompiers.

Enfin, pour clore notre parcours, arrêtons-nous non pas dans une galerie mais dans une grande salle où s’offre une petite exposition thématique. Comme l’an passé, lors de la première édition du Salon, une institution publique française a été invitée à présenter un aspect inédit de ses collections. Cette année, le Mobilier National expose de magnifiques tapisseries des Gobelins sur le thème de l’histoire d’Alexandre, ainsi que les cartons – récemment redécouverts – peints par les élèves de Charles Le Brun d’après les toiles de leur illustre maître qui font aujourd’hui la fierté du Louvre. Des esquisses préparatoires et des dessins sont également présents, des textes expliquent le processus de création d’une tapisserie royale, des modelli peints à l’œuvre tissée.
Ce furent deux heures de bonheur. Oubliez deux minutes Edward Hopper au Grand Palais. Courrez au palais Brongniart. Car c’est jusqu’à ce lundi soir.





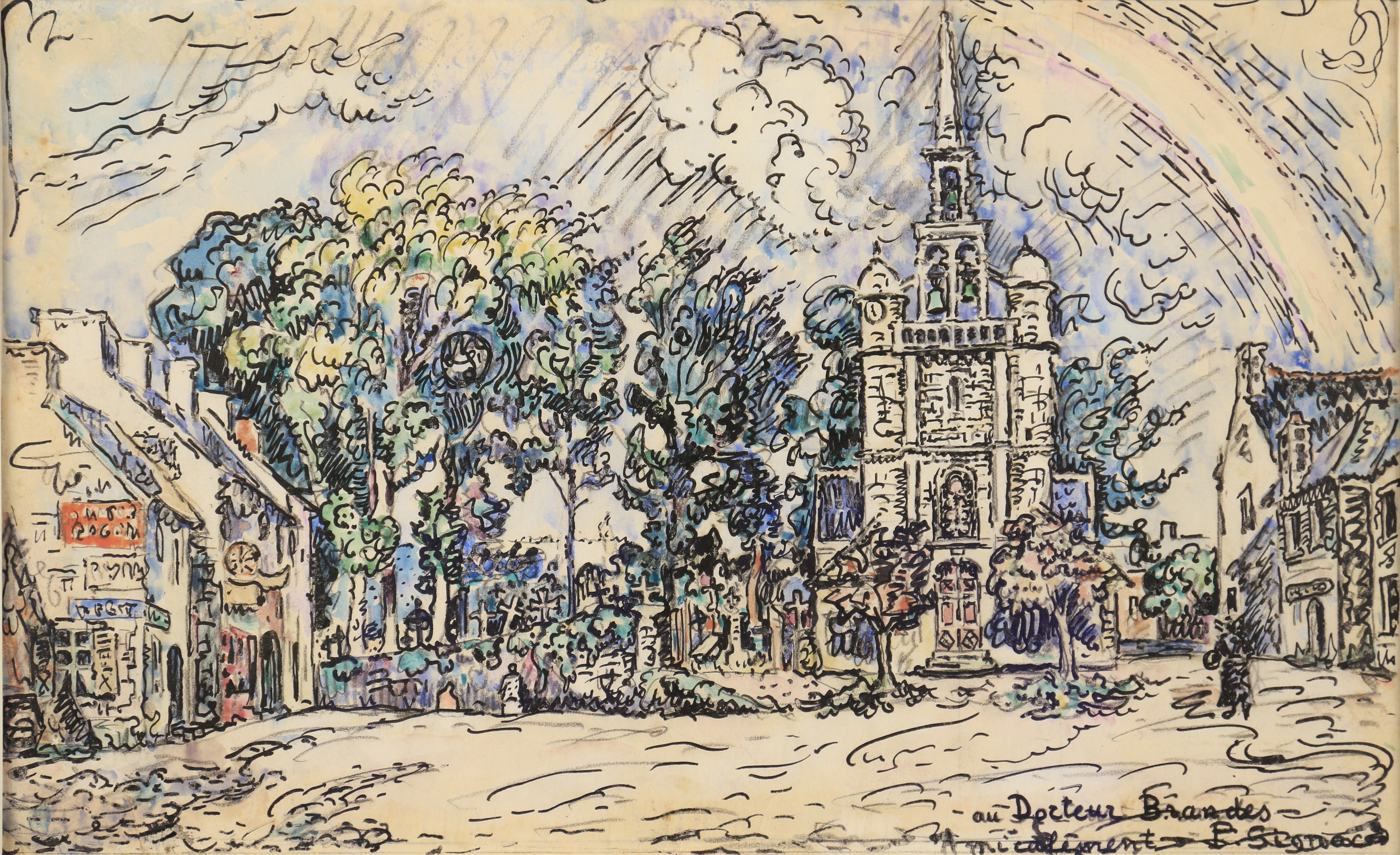


J’y retournerai la prochaine fois, c’est vraiment pas mal !! 🙂