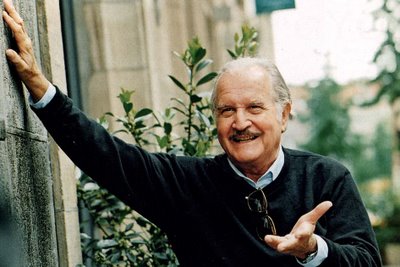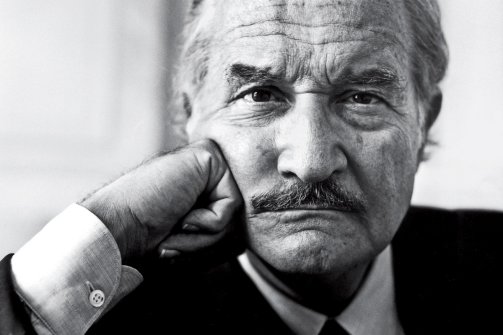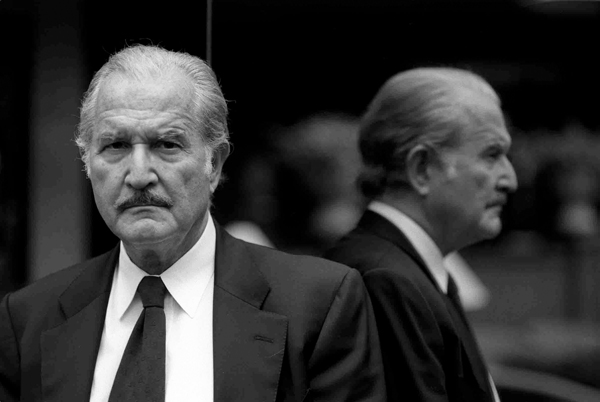Carlos Fuentes : un continent et son histoire
Fuentes n’a pas eu de mots assez forts pour dire la catastrophe que fut, dès l’arrivée de Cortès au Mexique et de ses homologues en Amérique latine, la Conquête espagnole pour le monde indien. Hécatombe démographique, dépossession générale des terres, esclavage économique (la mine obligatoire + le régime de l’encomienda), destruction culturelle et religieuse, désespoir et traumatisme de millions d’hommes partout dépouillés de leurs terres, de leurs Dieux, de leur identité et de leur humanité. Sont-ils de bons sauvages, vivant dans l’innocence, ou des païens idolâtres et cruels ? Ont-ils ou non une âme ? disputaient les Espagnols. Aventuriers âpres et idéologues cyniques l’emportèrent sans mal, dans les faits sur le terrain, sur les quelques humanistes, religieux et belles âmes qui prenaient en vain la défense des Indiens broyés de part en part par la Conquête la plus sanglante de l’Histoire.
Optimisme historique ? Culturalisme militant, un brin édénique ? En contrepoint de ce bilan tragique que fut la Conquête espagnole, Fuentes l’hispanique qui se défiait des modes et du revival indigénistes, oppose que les vaincus subvertirent silencieusement la religion et la culture du vainqueur, que les survivants aztèques et mayas, au rebours de leurs dieux ancestraux assoiffés de sacrifices humains, trouvèrent consolation et réconfort dans un Christ-dieu souffrant comme eux et salvateur, qu’ils firent leur la Vierge de Guadalupe, fine métamorphose écclésiastique des déesses-mères du panthéon déchu en sainte protectrice et aimante, que résulta de ce métissage des croyances et des hommes un mariage de fait entre hispanité et indianité qui généra le Baroque latino-américain et nourrit son syncrétisme grandiose.
A cette lecture de Fuentes de la Conquête espagnole et de ses effets jusqu’à nous, il convient de mettre en vis-à-vis les travaux, en France, de l’historien et anthropologue Nathan Watchez, avec son maître-livre, La Vision des vaincus, sous-titré Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole (Gallimard, 1971), qui décrit, récits indiens des temps funestes et archives espagnoles à l’appui, la destructuration totale d’un monde devenu brutalement absurde pour des millions de sujets réduits en esclavage, rendus étrangers à eux-mêmes et à l’univers symbolique et mental qui était le leur. Traumatisme historique qui perdure encore, ritualisé dans les fêtes des morts que sont les représentations populaires, venues du fond de cinq siècles d’acculturation forcée, qui mettent en scène la lutte fatale et désespérée entre Indiens et conquérants espagnols ivres d’or et de sang, telles qu’au Pérou, l’empereur Inca assassiné par Pizarre, au Guatemala, La Danse de la Conquête, ou encore La Danse des plumes, au Mexique.
Voici, non moins représentatifs de la douleur indienne, deux extraits d’un manuscrit maya du Yucatan, rédigé en lettres latines au cours des deux premiers siècles de la Conquête espagnole, Le Livre de Chilam Balam de Chumayel:
« Faux sont leurs rois, tyrans sur leurs trônes, avares de leurs fleurs. (…)
Frappeurs de jours, offenseurs de nuit, meurtrisseurs du monde !
Tordue est leur gorge, mi-fermés leurs yeux, nonchalante est la bouche du roi de leur pays. Il n’y a pas de vérité dans les paroles des étrangers. »
« C’est seulement à cause du temps fou, à cause des sacerdoces fous que la tristesse est entrée en nous, que le christianisme est entré en nous. Parce que les très chrétiens sont arrivés ici avec le véritable dieu. Mais ce fut le commencement de notre misère, le commencement du tribut, le commencement de l’aumône, la cause de la misère d’où est sortie la discorde occulte, le commencement des rixes avec les armes à feu, le commencement des offenses, le commencement de la spoliation, le commencement de l’esclavage par les dettes collées aux épaules, le commencement de la bagarre continuelle, le commencement de la souffrance. »
L’AMÉRIQUE : UN CONTINENT ET SON HISTOIRE – par Carlos Fuentes
Sous le signe de l’Utopie (RdJ, n°8, septembre 1992)
La Renaissance relança pour tous les Européens le problème des possibilités politiques de la communauté chrétienne. Elle posa à nouveau le thème de la cité de l’homme, effacé durant le Moyen Âge par l’importance accordée à la Cité de Dieu. Et donc, la Renaissance posa les deux questions suivantes : comment la société humaine doit-elle s’organiser ?, existe-t-il un espace où le projet divin et le projet humain puissent être harmonieusement réunis ? Thomas More, l’auteur de L’Utopie (1516), répond dans le titre même de son œuvre qu’un tel lieu n’existe pas. U-Topos signifie nulle part. Mais l’imagination européenne répondit très vite : maintenant, oui, ce lieu existe. Il s’appelle l’Amérique.
Selon l’historien mexicain Edmundo O’Gorman, l’Amérique n’a pas été découverte ; elle a été inventée. Elle a été inventée par l’Europe, car elle était devenue une nécessité de l’imagination et du désir européens. Pour l’Europe de la Renaissance, il fallait qu’il y eût un lieu heureux, un âge d’or restauré où l’homme vécut en accord avec les lois de la nature. Dans ses lettres à la reine Isabelle, Colomb décrivait un paradis terrestre. Mais au bout du compte, l’amiral crut avoir simplement retrouvé le monde antique de Cathay et de Cipango, les empires de Chine et du Japon. Amérigo Vespucci, l’explorateur florentin, fut le premier Européen à dire que notre continent, en fait, était un Nouveau Monde. Nous méritons son nom. C’est lui qui donna de solides racines à l’idée de l’Amérique comme utopie. Pour Vespucci, l’utopie n’est pas l’endroit qui n’existe pas. L’Utopie est une société, et ses habitants vivent en communauté et méprisent l’or. « Les peuples vivent en accord avec la nature », écrit-il dans son Mundus Novus de 1503. « Ils n’ont rien en propre ; en revanche, la jouissance des biens est commune. » Et s’ils n’ont rien en propre, ils n’ont pas besoin de gouvernement. « Ils vivent sans roi et sans autorité d’aucune forme et chacun est son propre maître », conclut Amérigo, confirmant l’existence de la parfaite utopie anarchiste du Nouveau Monde à son public de l’Europe de la Renaissance.
Dès lors, les visions utopiques de la Renaissance devaient être confirmées par les explorations utopiques des découvreurs de l’Amérique. « Brave nouveau monde, qui est habité par de tels gens ! », s’écrie Shakespeare dans La Tempête, et en France, Montaigne partage ce sentiment. Les peuples du Nouveau Monde, écrit-il, «vivent sous la douce liberté des lois premières et non corrompues de la nature». De son côté, le premier chroniqueur de l’expédition de Colomb, Pierre Martyr d’Anghera, devait se faire l’écho de ces sentiments en disant qu’ils « vont nus… et vivent dans un âge d’or simple et innocent, sans lois, ni querelles, ni argent, contents de satisfaire la nature », tandis que le premier chroniqueur du Brésil, Pedro Vaz de Caminha, écrivait en 1500 au roi du Portugal : « Sire, l’innocence d’Adam lui-même ne fut pas plus grande que celle de ces peuples. »
Mais le dimanche précédent Noël 1511, le moine dominicain Antonio de Montesinos, déjà, était monté en chaire dans une église de l’île Espagnole, d’où il avait fustigé ses ouailles espagnoles : « Dites-moi, de quel droit, au nom de quelle justice tenez-vous ces Indiens dans une si cruelle et si horrible servitude ?… Ne sont-ils pas des hommes ? N’ont-ils pas une âme rationnelle ? »
Bien sûr, de nombreux colonisateurs, et leurs défenseurs anti-utopiques en Europe, devaient nier que les aborigènes des Amériques eussent une âme, ou même qu’ils fussent simplement des êtres humains. Le principal d’entre eux fut l’humaniste espagnol traducteur d’Aristote, Juan Ginés de Sepúlveda, lequel, en 1547 ( c’est-à-dire après que les peuples du Mexique et du Pérou eurent été conquis par les Européens) nia tout simplement que les Indiens eussent une humanité réelle, et accorda tous les droits du monde aux Espagnols de les conquérir.
De telle sorte que les habitants du Nouveau Monde furent vus, alternativement, comme véritablement innocents, et comme des cannibales barbares et traîtres, qui vivaient nus et dans le péché. Tout au long de l’histoire de l’Amérique espagnole, le rêve du paradis et du noble sauvage allait coexister avec l’histoire de la colonisation du travail forcé. Mais l’illusion de la Renaissance persista en dépit de tout ceux qui la niaient, et devint une constante du désir et de la pensée hispano-américains. Nous avons été fondés par l’utopie ; l’utopie est notre destin.
Mais pour les colonisateurs, les terres récemment découvertes n’étaient pas précisément des sociétés idéales, mais d’inépuisables sources de richesse. Colomb insista sur l’abondance des bois, des perles et de l’or. Il s’agissait d’en arriver à la conclusion suivante : le Nouveau Monde n’est que nature. S’il est une utopie, il s’agit d’une utopie sans histoire ; la civilisation et l’humanité lui sont étrangères. Cette conclusion obligeait à décider si la foi et la civilisation devaient être données ou non aux Indiens américains par les Européens. Et aussitôt se posait la question de savoir si le destin des Indiens américains était de transformer le Nouveau Monde en un âge d’or au sens littéral, en travaillant dans les mines et les champs de ces pays que les Espagnols, par droit de conquête, considéraient maintenant de pleine propriété comme leurs. Les travaux forcés, les maladies européennes et, dans sa brutale simplicité, le choc culturel détruisirent la population indigène des Caraïbes. Certaines estimations de la population indienne du Mexique central donnent des chiffres aussi élevés que vingt-cinq millions à la veille de la conquête, la moitié seulement cinquante ans plus tard, « et à peine un peu plus d’un million en 1605 », selon Barbara et Stanley Stein, dans leur livre intitulé l’Héritage colonial de l’Amérique-latine.
La conquête et la reconquête du Nouveau Monde (extraits, RdJ, n°8, septembre 1992)
C’est un peu plus que pour ses prouesses militaires que Cortès doit être vu comme une figure singulière de la renaissance. Ce fut un personnage machiavélique qui se méconnut lui-même. Machiavel, à coup sûr, est le frère aîné des conquistadors du Nouveau Monde. Qu’est-ce en effet que Le Prince sinon un manuel destiné à l’homme nouveau de la Renaissance, l’homme nouveau qui se prépare à créer son propre destin, par le moyen de sa volonté, et en dépit de la providence, libéré d’obligations excessives au privilège hérité ou à la noblesse du sang? Le Prince conquiert le royaume de ce monde, le royaume de ce qui est la négation de l’Utopie. Mais Cortés fut le prince qui jamais ne fut.
*
La fuite des dieux, qui abandonnèrent leur peuple ; la destruction des temples ; les cités rasées ; le sac et la destruction implacables des cultures ; la dévastation de l’économie indigène par la mine et l’encomienda. Tout cela, en plus d’un sentiment quasi paralysant d’étonnement, d’émerveillement devant ce qui arrivait, obligeait les indigènes à se demander : Où donc trouver l’espérance? Il était difficile de découvrir ne fût-ce qu’une lueur dans le long tunnel que le monde indigène semblait parcourir. Comment éviter le désespoir et l’insurrection? Telle fut la question posée par les humanistes de la période coloniale, mais aussi par les plus sages et les plus astucieux de ses politiciens. Une réponse fut la dénonciation portée par Bartolomé de Las Casas. Une autre, les communautés utopiques de Quiroga et les collèges indigènes de la Couronne. Mais en réalité, ce fut le second vice-roi et premier archevêque du Mexique, Fray Juan de Zumárraga, qui trouva la solution durable : donner une mère aux orphelins du Nouveau Monde.
Au début de décembre 1542, sur la Colline du Tepeyac, près de Mexico, lieu jusque là dédié au culte d’une déesse aztèque, la vierge de Guadalupe apparut, portant des roses en hiver, et choisit un humble tameme, ou porteur indigène, Juan Diego, pour objet de sa reconnaissance. D’un coup de maître, les autorités espagnoles transformèrent le peuple indigène de fils de la femme violée en fils de la Vierge immaculée ; de Babylone à Bethléem, en un éclair de génie politique. La putain se transforma en Vierge et La Malinche en Guadalupe. Rien ne s’est révélé plus consolateur, plus unificateur, plus digne du plus féroce respect au Mexique, depuis lors, que la figure de la Vierge de Guadalupe, ou que celles de la Vierge de la Charité du Cuivre à Cuba, ou de la Vierge de Coromoto au Venezuela. Le peuple conquis avait trouvé sa mère.
Il trouva aussi un père. Le Mexique imposa à Cortés le masque de Quetzalcóatl. Cortés le refusa et, au contraire, imposa au Mexique le masque du Christ. Depuis ce temps-là, il est impossible de savoir qui est vraiment adoré sur les autels baroques de Puebla, Oaxaca et Tlaxcala : le Christ ou Quetzalcóatl ? Dans un univers habitué à ce que les hommes se sacrifient à leurs dieux, rien ne stupéfia davantage les Indiens que la vision d’un Dieu qui s’était sacrifié pour les hommes. C’est la rédemption de l’humanité par le Christ qui a fasciné et réellement vaincu les Indiens du Nouveau Monde. Le véritable retour des dieux fut l’arrivée du Christ. Le Christ devint la mémoire retrouvée, le souvenir du sacrifice originel des dieux au bénéfice de l’humanité. Cette nébuleuse mémoire, dissipée par les sombres sacrifices humains ordonnés par le pouvoir aztèque, fut alors récupérée par l’Église chrétienne. Le résultat fut un syncrétisme flagrant, le mélange religieux de la foi chrétienne et de la foi indigène, un des fondements culturels du monde hispano-américain. Et cependant, il existe un fait frappant : tous les Christs mexicains sont morts, ou du moins ils agonisent. Sur le calvaire, sur la croix, allongés dans des cercueils de verre, tout ce qu’on voit dans les églises populaires du Mexique sont des images du Christ prostré, sanglant et solitaire. Par contraste, les Vierges américaines, comme les espagnoles, sont entourées de gloire et de célébration perpétuelles, de fleurs et de processions. Et le décor même qui entoure ces figures, la grande architecture baroque de l’Amérique latine est en soi une forme de célébration de la foi nouvelle, mais elle est en même temps une célébration hasardeuse des vieilles religions survivantes.
La merveilleuse chapelle de Tonantzintla, près de Cholula, au Mexique, est une des plus frappantes des confirmations du syncrétisme comme élément dynamique de la culture de la contre-conquête. Ce qui s’est passé là s’est répété partout en Amérique latine. Les artisans indigènes reçurent des gravures des saints et d’autres motifs religieux des mains des évangélisateurs chrétiens, qui leur demandèrent de les reproduire dans les églises. Mais les anciens maçons et artisans des temples indigènes voulaient faire un peu plus que copier. Ils désiraient célébrer leurs anciens dieux, à côté des dieux nouveaux, mais ce dessein dut être masqué par un mélange d’éloge de la nature et d’éloge du ciel, en les fondant de façon impossible à distinguer.
Tonantzintla est, en effet, une récréation indigène du paradis indigène. Blanche et dorée, la chapelle est une corne d’abondance où tous les fruits et les fleurs des tropiques montent vers la coupole, vers le rêve de l’abondance infinie. Le syncrétisme religieux triompha et, avec lui, d’une certaine manière, les conquistadors furent conquis.
À Tonantzintla, les indigènes se peignent eux-mêmes comme des anges innocents sur le chemin du paradis, tandis que les conquistadors espagnols sont décrits comme des diables féroces, bifides et roux. Le paradis, après tout, peut être récupéré.
Le baroque contre l’orthodoxie (extrait, RdJ, n°1, mai 1990)
Le baroque a été le lieu de rencontre entre les cultures « vaincues » et « victorieuses » : une sorte de syncrétisme est né, qui est une culture de l’abondance mais aussi de la pauvreté, de la nécessité ; un baroque qui n’est pas seulement, comme ça peut l’être parfois en Europe, un style, un décor, mais qui correspond à une nécessité vitale, celle d’un lieu de rencontre, de confusion, de création, indispensable pour comprendre ce que nous sommes…