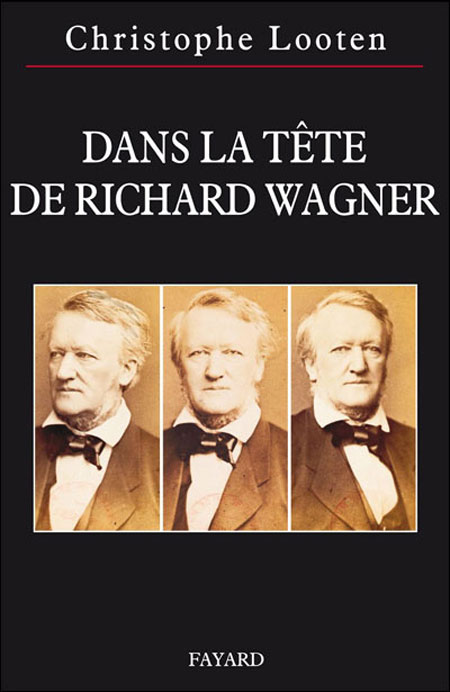Compositeur et théoricien, Christophe Looten consacre au génie allemand un essai passionnant et accessible, « Dans la tête de Richard Wagner », à partir d’une thèse aussi originale qu’éclairante : si le génie de Wagner réside dans sa musique, l’inspiration est à trouver dans ses lectures, et l’homme dans sa prose.
Wagner était un immense lecteur, recherchant les éditions rares, dépensant sans compter chez son relieur. Il a laissé deux bibliothèques, celle de Dresde dont il fut dépossédé lors de son exil de 1849, et celle qu’il constitua à son retour à Wahnfried, la maison qu’il fit construire à Bayreuth. Leur contenu, soigneusement recensé à la fin de l’ouvrage, permet de reconstituer l’univers intellectuel et culturel du compositeur, qui écrivait lui-même à sa maîtresse : « Chaque matin, avant de me mettre au travail, je lis un Chant de Dante : j’en suis encore à l’Enfer et je pense à ces horreurs en travaillant au deuxième acte de la Walkyrie ».
Wagner était-il écrivain ? Sa prose est en tout cas impressionnante, comprenant dix volumes d’œuvres complètes, des dizaines d’écrits, dont les majeurs Opéra et drame, Une communication à mes amis, Beethoven, les leçons de politique au jeune Louis II (Art allemand et politique allemande), deux autobiographies… Elle est profonde, pénétrante, originale : quittant les chemins déjà tracés de la polémique, Christophe Looten préfère citer la remarque de Wittgenstein : « Les hommes croient que les savants sont là pour leur donner un enseignement, et les poètes, les musiciens, pour les réjouir. Que ces derniers aient quelque chose à leur enseigner, cela ne leur vient pas à l’esprit ».
Que Wagner compare la musique à une femme enceinte, qu’avant Saussure, il tienne des propos prémonitoires sur la langue, qu’il lui plaise d’intervertir les trois vertus théologales (charité en premier, devant la foi et l’espérance), d’affirmer qu’une œuvre est d’autant plus grande qu’elle a été vite oubliée (tragiques grecs, Calderon et Shakespeare à l’appui), que le manque d’amour est la cause de la décadence de notre civilisation, ou de se faire visionnaire d’un monde où « seul ce qui est vil gagnera » (nous consolant cependant d’un « rien de ce qui est dénué de dignité n’est durable »), voilà qui ne peut laisser insensibles tous ceux que frustrent les abîmes d’ignorance dans lesquels nous ont laissé des Shakespeare ou Homère.
A ces idoles, à commencer par les « deux Prométhées » que sont Shakespeare et Beethoven, Wagner tend un passionnant miroir : « Shakespeare demeura absolument incomparable jusqu’au jour où le génie allemand produisit, en Beethoven, un être qui ne peut s’expliquer que par analogie avec le dramaturge anglais », écrit-il. A ces deux-là, seul Homère peut tenir compagnie : « La preuve qu’Homère a existé est que nous sommes certains que Shakespeare a vécu sur cette terre », affirme-t-il. Quant à Beethoven le sourd, il fait « sonner à nos oreilles (…) les personnages que se représentait l’aveugle Homère dans une danse héroïque ». « Homère aveugle, Beethoven sourd, ce sont là les deux pôles ! », s’exclame-t-il.
Mais c’est de ceux qu’il appelle leurs « frères », Eschyle et Sophocle, qu’il fut le plus directement influencé – le premier pour la Tétralogie, le second pour Tristan -, au point de faire dire à Nietzsche : « Le temps qui les sépare en apparence n’est au fond qu’un nuage qui nous empêche de distinguer les lois de cette relation. »
S’il mit des bémols à l’immense admiration qu’il vouait à Dante, Bach ou Calderon, c’est par défaut d’insoumission à la doctrine catholique. Insistant sur la supériorité du Faust sur le poème de Dante, il lui reconnaissait cependant l’avantage d’une « époque plus libre ».
La sienne lui laissa tout le loisir de développer une vision de l’amour qui ne rejoint le christianisme que tardivement, une fois rencontrée l’éthique de Schopenhauer, et dont il donna toute la mesure dans sa dernière œuvre, la plus profondément religieuse : Parsifal.