« Le moi est haïssable »
Pascal
« Je est un autre. »
Rimbaud
« Je viendrai, ce livre à la main… »
Rousseau.
J’eus une vision ; ce n’est pas le mur des siècles, qui m’apparut, mais un gibet. Celui de Villon. Et dès lors je me dis : « Qui sont ces pendus ? »
Je répondis : « Ce sont les Moi ; plus particulièrement, la plus redoutable espèce des moi : les artistes » ; oui, ce sont les artistes qu’il fallut pendre.
Reprenons.
J’ai publié, il y a deux jours, un petit texte de Ghislain Uhry, qui m’a donné à réfléchir, et surtout à extrapoler. Je voudrais partager un peu avec ceux qui m’accompagnent, avec mes amis, et pourquoi pas quelques lecteurs de ce petit « magasin » fort irrégulièrement achalandé, quelques réflexions. Elles ne prétendront pas faire système ; en revanche, elles traitent d’une question qui a toujours concerné le monde avec une extrême violence et une extrême acuité, et qui pourtant, aujourd’hui, peuvent se craindre inédites.
Il s’agit du Moi.
Un maître talmudiste, il y a peu, commentait non loin de mes oreilles un enseignement qui, précisément, en guise de quasi amorce de la tradition talmudique, requérait, en son fond, de forcer la clôture du moi ; mieux : de désinvestir le moi, « expérience originaire », disait-il, de son statut d’esprit. Tout le monde pense qu’il est un esprit, disait-il ; eh bien…
J’arrête ici ma citation, car là n’est pas mon objet ; mais, singulièrement, sa leçon, conjointement avec le texte de Uhry, m’a requis de dire, pour ce qui me concerne ici, quelque chose du moi littéraire, et du moi artistique ; et, pour commencer, du moi poétique.
Je commence par le lyrisme. Il y a toujours eu, de Théophraste à Catulle, d’Ovide à Villon, etc., des lyriques. Il y a sans nul doute des époques du lyrisme, mais il n’y en a pas qu’une ; il n’est jamais caduc, mais seulement oublié, ou vivace ; de demain, ou d’aujourd’hui. Qu’on parle de lyrisme, parle-t-on de Moi ?
Qui ne connaît la tarte à la crème hugolienne : « Hélas, quand je parle de moi, c’est de vous que je parle » ?
Tout un chacun reconnaît là une espèce de répartie à la Lagarde et Michard, un envoi d’Hugo à Pascal et son moi haïssable, ainsi qu’il advenait dans ce monde rassurant où si peu de moi avaient peuplé la littérature française – aujourd’hui, dans cette jungle de moi, qui irait parler à qui, quand tout grésille et fulmine et fume dans la matrice de tous les moi du monde ?… –
Et pourtant, comme il arrive parfois chez Hugo, ce n’est pas si bête : car oui, celui qui véritablement est lyrique, eh bien il ne parle pas de lui ; il ne parle pas de moi. Moi parle, sans doute, ou bien ?… En tous cas, il ne veut parler que de vous ; où l’on voit qu’à l’égard de l’autre de Rimbaud, Hugo fait, lui, le choix d’un pronom ; sans doute y a-t-il là plus de vrai courage que chez le jeune prodige. Il fit bien, en tous cas, de ne pas dire « nous » ; il eût encore un peu plus compromis le romantisme français dans la politique – il ne s’y est déjà que trop commis.
Par-delà la rhétorique un peu artificielle de tout cela, une chose est sûre ; qu’on veuille dire le lyrisme universel, ou communicatif, ou tout ce qu’on voudra, cela n’aura voulu dire qu’une chose : le lyrisme n’est pas le moi ; il en est même le contraire. Et qu’on y pense : quand Lamartine se lance, dans ces moments merveilleux où il oublie un moment cette horreur de la rhétorique qui a tant pesé sur son immense chant ; quand Hugo, quand Villon, quand Keats entonnent le leur, qui serait assez bête pour voir passer là un moi ? Ne sait-il pas, tout lecteur, que lorsque vraiment cela jaillit, cela s’impose, comme une vague qui, justement, ébranle et bouscule et déracine le moi, frileusement abrité sur la digue, au bord de l’eau ? nul besoin de s’extasier devant l’étrangeté du paradoxe diderotien, qui voit jouer si mal l’acteur qui joue d’âme, tandis que la Clairon joue si bien – il n’est question, si ce texte est profond, que d’ébranlement du moi, celui-là même qui donne aux textes de Jouvet sur le théâtre, d’après le maître talmudiste cité plus haut, leur dimension « prophétique » : être un grand acteur, c’est cesser d’être moi ; c’est être plus que moi.
Dès lors, c’est la critique du lyrisme, ce sont les poses affectées, les roulements de mécanique symbolistes qui semblent singulièrement factices et spécieuses ; quand on parle, autour de la fin du siècle, après les injonctions rimbaldiennes et les fumigations mallarméennes, jusqu’à ce cher et frêle Rilke, d’objectivité, d’impersonnalité, de quoi parle-t-on ? Depuis quand le lyrisme a-t-il eu de la personnalité ? Le suffixe trahit le mensonge ; rien de conceptuel, si le lyrisme est vrai ; rien de conçu du moi qui parle, mais seulement le grand vent, le « grand vent » de l’intentionnalité, aussi bien : être lyrique, c’est être furieusement arraché à la « moite intimité gastrique. »
Mais qu’est-ce à dire, alors ? Pourquoi, si la pose et l’affirmation étaient spécieuses, Mallarmé a-t-il si fortement forclos, justement, le chant poétique, et le lyrisme en général, dans sa petite boîte à pilules poétiques, où la marque des bonbons à l’anis était « Aboli » ?
Que justement, ce que les papes, les prêtres, les encenseurs de l’impersonnalité, ont fait triompher, c’est… le moi.
Car, finalement, de quoi s’agit-il ? D’une grande œuvre, absolue, impersonnelle. D’une grande œuvre qui pense. D’une grande œuvre qui dise la tragédie, ou tout ce qu’on voudra pour faire un complément du nom, du langage. Bref, de l’essentiel. Bref, de l’absolu. Dites-moi, vous pensez qu’on n’a jamais pensé avant Mallarmé ? Vous pensez que Lamartine ne pensait pas ? Seriez-vous à ce point la dupe de vos classes d’hypokhâgne, cher lecteur ?
Car oui, Mallarmé pense. Mais qui pense ? Je réentends la voix de mon maître talmudiste : celui qui pense… c’est moi. Descartes nous l’a fort joliment dit. C’est d’ailleurs tout le problème, avec la poésie mallarméenne : c’est tout le problème de la souffrance mallarméenne. Il souffre parce que, captif d’un moi clos, il en requiert de l’impossible ; du divin, ou de l’athéisme – ce qui n’est pas si dissemblable, quand on prend les deux mots au sérieux. Pour peu qu’on prenne au sérieux ce discours – Sartre le fit – on pourra lui dire à bon droit : « Mais cher Monsieur, empêtré dans votre impossible, qui vous a demandé d’être Moi ? »
En tous cas, quod erat demonstrandum, nulle poésie n’est plus personnelle, si par personnelle on veut parler de ce qui révèle le Moi, que celle de Mallarmé ; nulle poésie, en France, n’est plus impersonnelle que la bonne poésie de Lamartine.
Le problème, c’est que Mallarmé n’est pas le seul ; il vivait d’ailleurs bien mieux que nous ne l’imaginons. Nous avons tellement idolâtré son œuvre, encensé sa « pensée », que nous l’avons perdu de vue. En fait, le cher homme appartient en propre à la France bourgeoise, qui a donné tout de même l’impressionnisme, lequel, à part l’exception de Monet, est l’histoire du plus subtil, du plus délicat, du plus saisissant embourgeoisement collectif. Les peintres ont toujours portraituré les gens fortunés (Frantz Hals) ; ce qui est plus singulier, c’est qu’à force de peindre les bourgeois, on le devienne – et qu’une peinture, d’abord conspuée, soit reçue par les bourgeois (reçue, acceptée, et qu’elle en devienne même, d’une certaine façon, l’emblème).
Il en advint exactement de même avec Mallarmé : bourgeois lui aussi, professeur, ami fanatique des impressionnistes, il a figuré le plus radicalement trangressif des poètes (à en croire Sartre) ; mais aussi bien, il a été le plus parfaitement bourgeois des artistes – et il a été reçu par ce qui constitue la plus pure émanation de la bourgeoisie : la classe des professeurs.
Mais en fait, il n’y en a pas qu’une ; il y a deux pures expressions des bourgeois, si, par bourgeois, on doit entendre comme le voulait le triplement cité talmudiste, la clôture du Moi, et, plus largement (de façon plus divertissante) la satisfaction du Moi. Les professeurs, donc, et les artistes. Car depuis qu’elle a chassé le lyrisme, la poésie est devenue la plus satisfaite, et donc la plus laide des formes d’expression ; et, plus généralement, depuis qu’il a chassé le lyrisme, l’art est devenu le plus abject des modes d’exister, et cela, parce que l’art est aujourd’hui la forme la plus bourgeoise de l’existence.
Il y eut Bouguereau, Couture, et les pompiers ; il y a l’art conceptuel. Il y eut Lully, il y a Boulez.
Quels furent les grands acquis de l’art conceptuel ? L’abyssale complexité conceptuelle, la commentabilité censément infinie des réalisations. Le remplacement d’un discours (naïf) par une forme (intelligente) ; la valeur philosophique, et souvent psychanalytique des œuvres.
Tout cela, je l’appelle supercherie. Supercherie qui ne convainc que les fanatiques, que les militants, ceux-là même qui de toutes façons ne célèbrent et ne louent que par réflexe de classe ; je nomme très exactement les bourgeois. Je nomme très exactement les artistes, et leur public – journalistes ET artistes ET professeurs, car, aujourd’hui, Dieu (mort) soit loué : les trois catégories jusqu’alors hermétiques et closes ont fusionné en une seule et unique, redoutable et auguste comme un monothéisme.
Supercherie qui reprend, collectivement, les mêmes axiomes que l’athéisme mallarméen. Supercherie qui, sans nul doute, a été nourrie de la modernité, qui fut, en gros, la célébration proprement idolâtrique des pouvoirs du moi : il fallait donc des génies – Stravinsky, Picasso, Joyce. Tous trois, c’est notable, ont joué fortissimo la partition de l’autoproclamation. Puis vinrent les héritiers ; on le sait, il y a toujours une grande différence entre les self-made-men qui fondent les empires, et les héritiers fortunés. Nul génie, chez les héritiers ; nulle surperformance ; mais la même pose, héritée de la surperformance des pères.
Et pourtant, ayons le courage de le dire, les pères, n’était le pouvoir proprement extraordinaire de leur main, étaient déjà intégralement et suprêmement satisfaits d’eux-mêmes, et clos sur eux-mêmes ; plus nulle place n’était laissée, chez eux, à l’irruption dans le geste artistique d’un vouloir extrinsèque au moi ; « je ne cherche pas, je trouve » – chercher, c’est lancer justement une sonde par-delà soi ; tout est en moi, répond Picasso – répond Picasso exactement comme un bourgeois de Balzac.
Je rajouterais même : comme un athée parfait. Oui, l’athée parfait (qui n’est pas l’athée sérieux dont je parlais plus haut ; merci à Jean-Claude Milner pour sa distinction de l’athée vulgaire et de l’athée de probité), parfaitement autosuffisant, est un bourgeois parfait – clos sur soi, maître de soi. Le bourgeois et l’athée sont le même homme.
Faut-il en rajouter ces artistes qui se font la proie rêvée des professeurs ? Qui écrivent pour les universitaires, qui peignent pour les commissaires (d’exposition, c’est à dire de police ?)
N’est-ce pas évident ?
L’artiste est déjà professeur ; il prend sur lui, seulement, le fardeau d’une production (tout de même, de plus en plus léger à porter, puisqu’il requiert de moins en moins de savoir faire, et de moins en moins d’objets fournis) ; le professeur, le commissaire, plus paresseux, ne font que rejouer, que répliquer à l’infini la petite musique de moi, la petite musique de nuit du Moi, préludée par le premier.
Trouvons nous dans une de ces cavernes où les artistes affluent en masse, allez ; rendons-nous à un grand vernissage. Qu’entendons-nous, qu’entendons-nous seulement ?
Moi.
Et dès lors, s’il reste du cœur à un homme, que peut-il désirer, sinon fuir, sinon jamais n’appartenir à cette coterie monstrueuse, où chacun se soutient de l’autre, où tous étant mêlés ensemble, la même effarante limite, la même abrutissante médiocrité se soutient de soi, parce qu’il n’y a rien de plus respectable, de plus nécessaire, parce qu’il n’est nul autre acquis de la liberté, nulle autre liberté politique que… le moi ?
Pourtant Nietzsche l’avait dit, leur prophète – qu’ils disent ! Car il n’en est pas un qui se tienne à la hauteur où lui s’est tenu, dans son athéisme propre : L’homme est un pont est non un but. Haine de l’homme, haine du moi. Le moi, certes, Monsieur Pascal, est haïssable.
Je voudrais dire ceci : ceux qui, par nécessité ou par faiblesse (l’un est souvent le masque de l’autre, pour le pire et le meilleur), se veulent encore artistes, ou poètes, ceux qui ont aimé le chant ou la danse de la main, car, tout de même, il y a Monet, il y a Titien ; il y a Shakespeare, il y a Keats, il y a Hölderlin… Je voudrais dire ceci, pour moi-même, et pour mes amis, sur le mode un peu pompeux, un peu ridicule (aujourd’hui) de l’injonction : s’il vous reste encore, dans l’immense délire, dans l’horrible hurlement de la folie narcissique où l’Occident se précipite en une fuite en avant (et dont il mourra s’il ne se reprend pas), le désir de vous faire poète, ou artiste, que ce ne soit pour rien d’autre que pour lutter contre la bête immonde – moi. Humez le monde, hors de vous. Humez-le dans vos gestes, comme le vieux Monet en 1920. Humez-le dans vos mots, dans vos chants, comme Keats qui pèse ses voyelles en regardant d’un œil si fragile son dernier automne ! Humez tout ce qui vous arrache à l’infamie du bain rituel collectif du moi, qu’on appelle la culture ; arrachez-vous à France Culture, à la question émolliente, complaisante, mielleuse de l’universel Journalisme.
Pactisons, parce que l’heure est grave. Pactisons, en imitant notre ami Rousseau, qui lui aussi ne fut jamais un moi pour s’y abriter, mais fut moi pour y recevoir la gifle et l’ébranlement du vivre : si vous êtes artistes pour être « moi », soyez dès à présent certains que vous êtes maudits, et qu’il n’y a là rien de glorieux – parce que vous êtes morts. Mais si, finalement, c’est en tremblant que vous apposez votre nom sur votre tableau, sur la couverture de votre livre, parce que vous espérez (et il est difficile de le savoir !) que ce tableau, et ce livre, auront été, sur le mode un peu empirique, un peu pataud, un peu bricolé qui fait la vie d’artiste, une sortie hors de moi, oui, lyrique, oui, aventureuse, oui, vivante, alors c’est avec la même fierté que, comme Rousseau, vous pourrez vous présenter devant le Souverain Juge.
Et vous savez qui c’est, le souverain juge ?
Merci, ami talmudiste. Ce n’est pas moi.
C’est l’esprit.
Et dès lors, je compris enfin le plus beau vers de la Ballade des pendus :
Quoique fûmes occis par justice.




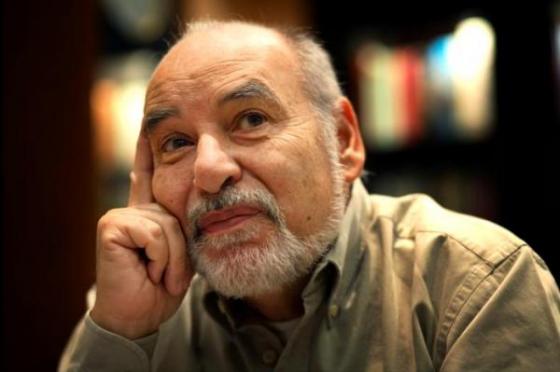
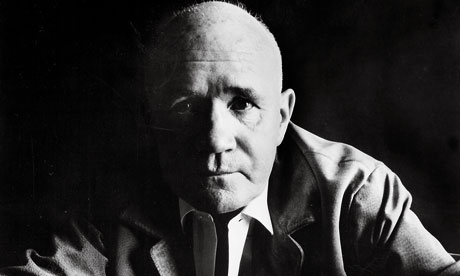


Moi qui cro(ya)is…
Moi qui avais cru Schönberg, lorsqu’au terme de sa vie, le père du dodécaphonisme murmura à l’oreille de la postérité que l’on pourrait longtemps encore composer des chefs-d’œuvre en do majeur.
Quand il y a vingt ans, je me lançai à corps perdu dans la chevelure d’Euterpe, les apparatchik boulézistes se chargèrent de me faire comprendre qu’il me faudrait, la prochaine fois, gommer de mes portées tout tonalisme dorénavant proscrit. Lully faisait jeter ses concurrents à la Bastille, Boulez, à sa façon, m’a embastillé. Quand je dis, à sa façon, c’est à la chambre sourde que je fais allusion. Cette cellule capitonnée de l’IRCAM hors de laquelle il repousse tout ce qui ne ressemble pas à la société sérielle, puis aléatoire, telle qu’il la prône. L’artiste figé dans le mouvement qu’il incarne, annule par là-même ce mouvement. Il enferme tout ce qui se meut à l’extérieur de cette forteresse organique où ses disciples se laissent savoureusement ingurgiter par le maître kronien.
L’épreuve du désert est très possiblement une épreuve volontaire. Elle ne peut que l’être. Elle l’est du fait qu’elle devrait l’être si elle ne l’était pas. Je dirais même qu’elle devrait être si elle n’était pas. Car au fond, qu’y eût-il de moins complexe au monde que d’inscrire mes fréquences sonores, rythmiques et dynamiques dans l’un des innombrables tableaux programmés par notre statisticien en chef, à l’intérieur des cases leur étant assignées? Or ce qui pourrait sembler le plus aisé sera le plus malaisé à qui cela provoquerait un perpétuel malaise.
J’entends ce que j’entends. Serviteur d’une Création qui ne laisse de place qu’à l’ex-istant, Je ne prend la place de personne. Sa liberté procède de l’acceptation de sa privation de liberté. Il ne saura posséder qu’après qu’on lui aura pris tout ce qu’il croyait détenir. Ici se joue la rupture entre Sigurdr et Moshè. Mystère d’une opposition qui ne se voit pas, entre la fatalité des réactions en chaîne inculquées par les dieux à des marionnettes humaines et la liberté de suivre ou non la seule voie de l’action divine.
Et servant de pendant au vers de Villon,
quoique fûmes occis
Par justice.
je noue ce diamant de Christine de Pisan :
Seulette suis et seulette veux être,
Magistral !
Quid de B.H. et de son moi ? Est-il un pont (ce que je pense), ou un but (ce que pense la maison « France-Culture ») ?
GH