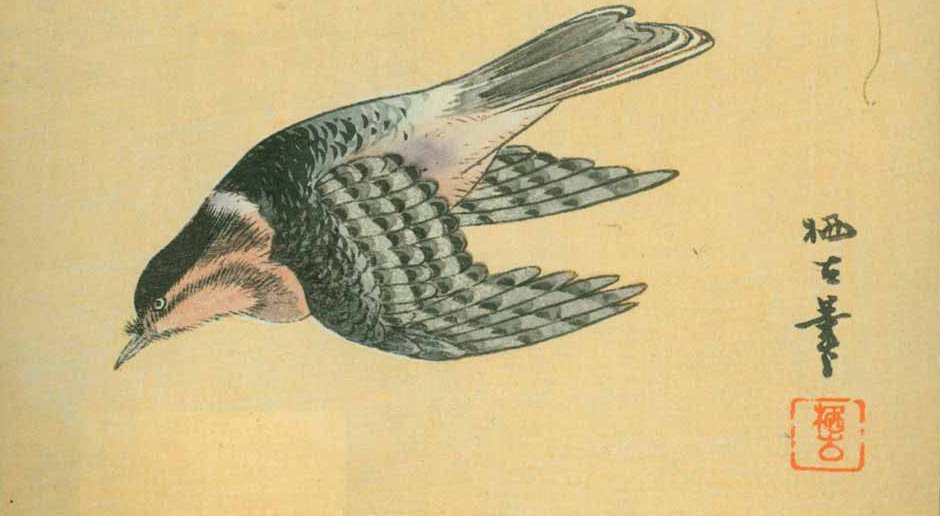John Keats est un poète parmi les plus grands. Son écriture extraordinaire a donné lieu, en France, à quelques grandes admirations, et à une étude d’une remarquable qualité d’écoute. Pour les premières, je citerai Charles du Bos ; pour la deuxième, la longue préface écrite par Albert Laffay, « professeur de première supérieure », dans l’édition des Selected poems chez Aubier.
Je ne vous dirai pas que Keats est « d’une actualité brûlante », qu’il est notre « grand contemporain », en vertu d’une quelconque association d’idée avec l’Islam conquérant, la planète en péril, ou la France en déclin. Si, pour moi, Keats est si vital, c’est qu’il est beau ; c’est que ses consonnes crépitent, c’est que ces voyelles planent, dans ses odes, avec une grâce et une lenteur, une richesse surtout que je ne crois avoir jamais entendues dans une œuvre poétique.
Voici donc la première d’une série de traductions, que je compte publier avec la préface de Laffay. J’ai tenté, au moyen d’artifices, non de traduire les images de Keats, non son discours, mais, autant que faire cet impossible se peut, son poème. Raison pour laquelle j’ai conservé, malgré le handicap d’un français plus long, le mètre de Keats (le décasyllabe) ; j’ai tenu, sinon aux rimes, du moins à une écriture assonancée ; et j’ai tenté d’animer ma traduction de mouvements parallèles à celui du poème keatsien : où ses mots se mettent à peser et de gorger de suc (pour emprunter à son extraordinaire autumn), tentant à mon tour de charger mon vers, quoique notre français germine plus en « Le Nôtre » qu’en « Capability Brown »… Au moins, où son rythme ralentit et s’étale, j’ai accumulé les « e » finaux et les froissements de consonnes difficiles, pour forcer la diction à ralentir « en mesure ».
Un moment de sincérité, lecteur ? Je me souviens d’une conversation avec le merveilleux Vladimir Dimitrijevic, le directeur de l’Âge d’Homme, dans sa voiture – un des derniers parmi ces hommes qui ont vraiment voué leur vie à la grande écriture, et qu’on a ostracisé pour des raisons bien extrinsèques à la question, tout de même ; il me disait, avec ses r qu’il roule avec tant de délicatesse : « tout de même, Pascal, quand on rrregarde un Lamartine, même si on s’est acharné à dire que c’était bête, on a un peu honte devant tant de grâce ! »
J’opinai à demi : certes, de la grâce, mais gâchée par la maladie politique qui a trop souvent fait tourner nos grandes voix poétiques, comme la soupe – tourner à la rhétorique. Alors c’est avec Keats que je m’y mets à mon tour : tout de même, lecteur, quand on vit à l’époque et dans le radieux pays du président Sarkozy, qui nous disait avec son accent impayable, lors d’une de ses dernières interviews télévisées, au sujet de sa femme « Moi vous savez, jsuis quelqu’un comme tout l’monde » ; dites-moi, quand nous lisons du Keats, n’avons-nous pas un tout petit peu honte ?
Voici le poème :
TO AUTUMN
Season of mists and mellow fruitfullness,
Close bosom-friend of the maturing sun ;
Conspiring with him how to load and bless
With fruit the vines that round the thatch-eves run ;
To bend with apples the moss’d cottage-trees,
And fill all fruit with ripeness to the core ;
To swell the gourd, and plump the hazel shells
With a sweet kernel ; to set budding more,
And still more, later flowers for the bees,
Until they think warm days will never cease,
For Summer has o’ver brimmed their clammy cells.Who hath not seen thee oft amid thy store ?
Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary floor,
Thy hair soft lifted by the winnowing wind ;
Or on a half-reap’d furrow sound asleep,
Drows’d with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers :
And sometimes like a gleaner thou dost keep
Steady thy laden head across a brook :
Or by a cyder-press, with patient look,
Thou watchest the last oozing hours by hours.Where are the songs of spring, ay, where are they ?
Think not of them, thou hast thy music too.
While barréd clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue ;
Then in a wailful choir the small gnats mourn
Among the river sallows, borne aloft
Or sinking as the light wind lives or dies ;
All full-grown lambs loud bleat from hilly bourn ;
Hedge-crickets sing ; and now with treble soft,
The red-breast whistles from a garden-croft ;
And gathering swallows twitter in the skies.Et voici la traduction :
A L’AUTOMNE
Saison de brume et des foisons mûries,
L’amie de cœur du Soleil qui les dore ;
Tramant ensemble un faix béni de fruits
Aux vignes qui jusqu’au chaume s’étirent ;
Chargeant de pommes les vergers moussus,
Comblant tout fruit jusqu’en son coeur, de suc;
Gonflant la courge, arrondissant la coque
Pour l’amande sucrée ; faisant éclore,
Encor ! d’ultimes fleurs pour les abeilles,
Qui croient alors aux tiédeurs éternelles :
D’excès d’été, les ruches leur débordent.
Tous t’aperçurent, toi qui hantes ton antre !
Qui partout s’en enquiert parfois te peut
Trouver sur l’aire, assise insoucieuse,
Cheveux flottants que le vannage évente ;
Ou bien dormant en vapeurs opiacées
Sur un sillon à demi dénudé
– A l’andain laissant ses fleurs enlacées – ;
Ou bien glaneuse, qui s’efforce d’avoir
Roide la tête lourde, passant le source ;
Ou au pressoir à cidre, d’un calme voir
Fixant, heures durant, d’ultimes gouttes.
Ô les chants de printemps, oui, où sont-ils ?
N’y songe pas, tu as tes sons aussi !
Les nuées fleurissent le jour qui meurt doux,
Teintent de rose les plaines par touches :
Lors, en chœur triste crissent les moustiques
Entre les saules tantôt soulevés,
Tantôt penchés selon le sort des brises ;
De grands agneaux bêlent lourd sur la butte ;
Aux haies des grillons chantent ; en doux tremblé,
Un rouge-gorge siffle d’une hutte ;
Les hirondelles trissent jusqu’au ciel.