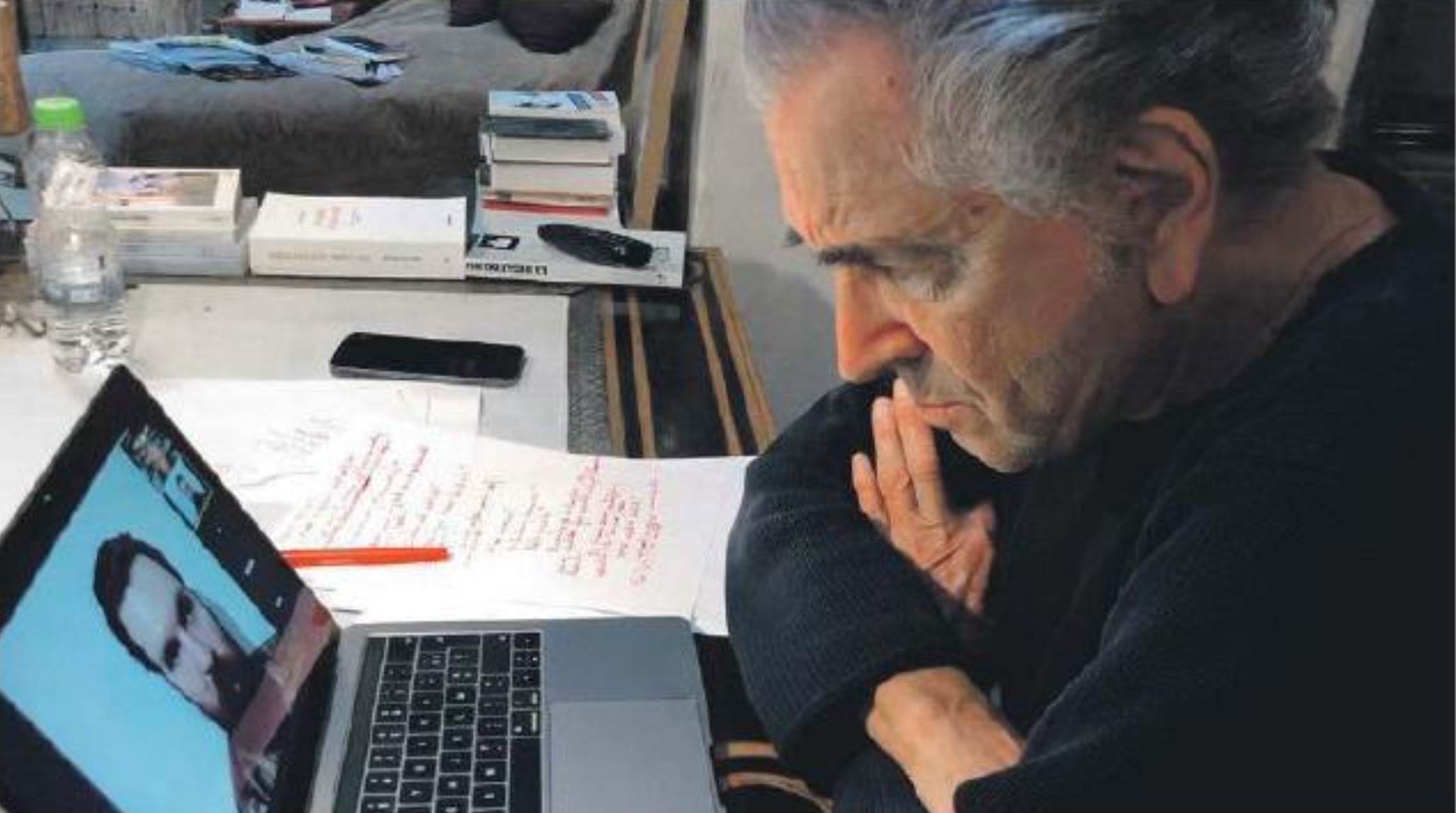Comme l’affirme Michael Prazan dans son film remarquable, c’était probablement l’épuisement psychique des bourreaux, malgré l’aide souvent très efficace d’auxiliaires locaux, qui finalement poussa la direction nazie à adopter des méthodes plus industrielles de l’extermination humaine : les chambres à gaz. Mais si tout le monde en Occident connaît les chambres à gaz, pourquoi ce génocide atroce par balles et parfois même à l’arme blanche, génocide qui n’épargnait même pas les hommes et les femmes aptes au travail et en bonne santé, comme c’était le cas lors des fameuses « sélections » à Auschwitz, est-il resté si longtemps ignoré en Occident?
La cause première de cette ignorance, c’est l’occultation du caractère ethnique de l’extermination des Juifs sur le territoire de l’URSS par le régime soviétique. Déjà pendant la guerre, confronté à la fois à la propagande antijuive nazie dans les territoires occupés par l’ennemi et à l’antisémitisme populaire traditionnel qui a pris de l’essor grâce à cette propagande (surtout en Ukraine et dans les pays Baltes), Staline choisit de minimiser le génocide hitlérien. À de rares exceptions près, la presse parlait uniquement de massacres de civils et d’atrocités à l’égard des citoyens soviétiques[1].

Le long de la guerre, Staline avait une double politique juive. D’une part, devant une situation désastreuse dans les premiers mois après l’invasion de l’URSS par les nazis, il prit la décision, en avril 1942, de créer le Comité Antifasciste Juif dont les membres étaient des écrivains, des acteurs, des scientifiques et des militaires juifs. Le Comité s’occupait de la collecte de fonds auprès des Juifs américains et britanniques et oeuvrait en faveur de l’ouverture du Second front. C’était la facette de la propagande soviétique destinée à l’étranger[2].
D’autre part, Staline continua sa politique antisémite engagée à la fin des années 1930 visant à épurer graduellement l’appareil du parti et l’appareil soviétique des Juifs sous l’appellation de « combat pour la pureté nationale des cadres »[3]. Lors de la visite de Ioachim von Ribbentrop à Moscou, le 23 août 1939, pour la signature du Pacte germano-soviétique (dont les clauses secrètes scellaient le partage de l’Europe de l’Est), Staline aurait porté le toast à la santé d’Hitler et ajouté : « Je n’attends que le moment quand l’URSS aura suffisamment de sa propre intelligentsia (ce qui veut dire ethniquement russe – G.A.) pour en finir avec la dominance des Juifs dont on a encore besoin »[4]. C’était la facette de la politique intérieure de Staline (encore cachée de la population générale) dictée non seulement par son antisémitisme personnel, mais surtout par son orientation de plus en plus nette vers les valeurs grand-russes traditionnelles.
Cependant, à la fin de la guerre et jusqu’à 1947, il y eut un nombre de publications dans la presse soviétique sur les atrocités nazies à l’égard de la population juive, appartenant à des grandes plumes comme Ilya Ehrenbourg ou Vassili Grossman, célèbres correspondants de guerre et écrivains. Leur notoriété et leurs liens étroits avec le Comité Antisfasciste Juif qui jouissait d’une grande autorité à l’étranger, auprès des alliés (par exemple, le président du CAJ, le grand metteur en scène et acteur Salomon Mikhoels, était lié d’amitié avec Albert Einstein), rendait la tâche des censeurs délicate. Mais dès 1947, ce sujet devient complètement tabou. Staline interdit notamment la publication du « Livre noir » des crimes nazis, basé sur les témoignages rassemblés par Grossman et Ehrenbourg.
Il y avait plusieurs raisons pour ce tournant. L’URSS entrait dans la période de la guerre froide, et les Juifs, qui formaient une communauté « extranationale » et étaient soutenus par les communautés juives américaines, britanniques ou par les « sionistes » installés en Palestine, semblaient de plus en plus suspects aux yeux de Staline.
Et puis, il y avait une réalité de l’antisémitisme populaire renforcé encore par le retour des Juifs survivants sur leurs lieux de résidence. À la Libération, les dirigeants du Comité Antifasciste Juif reçurent des milliers de lettres de Juifs qui se plaignaient amèrement de l’antisémitisme ambiant[5]. En Ukraine, par exemple, les Juifs qui avaient eu le temps de partir en évacuation ou qui avaient servi dans les rangs de l’armée soviétique, et avaient donc réussi à éviter le sort funeste de leurs proches, n’arrivaient pas à récupérer leurs appartements qu’ils avaient occupés avant la guerre. Souvent, on leur refusait le travail, et à Kiev, en septembre 1945, il y eut même un pogrom violent qui se solda par cinq meurtres et plusieurs dizaines de blessés graves[6].
Enfin, confronté à une résistance féroce à la réoccupation soviétique à la fin de la guerre, surtout en Ukraine occidentale et dans les pays Baltes[7], Staline voulait apparemment à tout prix se démarquer du cliché nazi qui associait les communistes et les Juifs. Il fallait démontrer à la population soviétique, et surtout à celle des régions nouvellement occupées, que le régime communiste actuel, désormais imprégné des valeurs nationalistes russes, rejetait l’héritage bolchevique « enjuivé » et n’avait plus aucune affinité avec les Juifs[8].
En janvier 1948, la politique antisémite de Staline prend un tournant plus radical. Le signal en fut donné par le meurtre de Salomon Michoels camouflé en accident. Il fut assassiné à Minsk, sur l’ordre direct de Staline, ce qui inaugura, peu de temps après les funérailles nationales de cette figure proue de la vie culturelle juive, la campagne de la lutte contre le « cosmopolitisme » : en clair, l’ère de la destruction de la culture juive traditionnelle, accompagnée de l’extermination physique de plusieurs personnalités juives éminentes[9].
Bien sûr, la création de l’État d’Israël apporta un argument de plus à l’antisémitisme du régime soviétique. L’URSS soutint activement la création de l’État d’Israël, pour contrer les plans britanniques d’une hégémonie au Proche-Orient, à ce point que probablement, sans le soutien soviétique, l’État juif n’aurait pu naître. D’un autre côté, Staline fut enragé par le soutien de très nombreux Juifs soviétiques à leur « patrie historique ». Des milliers de Juifs soviétiques, souvent parfaitement assimilés, adressaient au Comité Antifasciste Juif des demandes d’organiser des collectes de fonds pour l’armée de la Palestine. D’autres manifestaient leur désir de se battre aux côtés de leurs frères en Palestine. Les troisièmes demandaient carrément le droit à l’émigration[10].
Dès lors, le sort des Juifs soviétiques fut scellé. Guennadi Kostyrtchenko traite la politique stalinienne entre 1948 et 1953 d’« assimilation punitive ». On liquide les théâtres juifs, on interdit des associations d’écrivains juifs et des publications en yiddish, on interdit l’enseignement du yiddish, on ferme des synagogues. On procède à l’expulsion quasiment totale des Juifs, même parfaitement assimilés, de l’appareil du Parti communiste et de l’État, de l’armée, de l’industrie (surtout de l’industrie militaire), de la science, de tous les domaines de la culture, de l’enseignement, etc. Des milliers de personnes furent jugées et condamnées à la mort ou à de lourdes peines de prison pour « espionnage » ou simplement pour « sionisme ». Les purges se produisent même au Birobidjan, la région autonome juive dans l’Extrême Orient, créée sur l’ordre de Staline dans les années 1930 pour démontrer la solution socialiste au « problème juif »[11].
Après le procès à huis clos du Comité Antifasciste Juif (1952), dont l’un des chefs d’accusation était le travail sur « Le Livre noir » et qui se solda par 13 condamnations à mort des grandes personnalités juives, une véritable hystérie collective fut organisée autour de l’« affaire des Blouses blanches », docteurs faussement accusés de tentatives d’empoisonnement de dirigeants soviétiques. Et même si la mort de Staline en mars 1953 empêcha la réalisation d’un plan d’épuration ethnique massive, plusieurs restrictions visant les Juifs soviétiques restèrent inchangées jusqu’à l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir[12]. C’est aussi jusqu’à son arrivée au pouvoir que l’on continua à occulter la shoah, à quelques exceptions près à l’époque du « dégel », comme la publication du poème de Evgueni Evtouchenko « Baby Yar » en 1961[13].
Comme les « pays frères » européens suivaient à la lettre la politique soviétique, l’occultation de la shoah survenue dans leurs territoires respectifs était de mise partout en Europe de l’Est. Ni à Auschwitz, ni à Baby Iar (Kiev), ni au 9e Fort (Kaunas)[14], les plaques commémoratives ne faisaient aucune mention du génocide juif : on parlait de l’extermination de citoyens français, soviétiques, hongrois, et j’en passe. Pendant des décennies, Israël resta le principal dépositaire de cette mémoire, au mémorial Yad-va-shem, à Jérusalem.
Je reviens maintenant au film de Michael Prazan. Il est regrettable que cet écrivain et réalisateur qui a fait par ailleurs un travail de recherche exemplaire, blanchisse trop le régime stalinien : il montre des images de procès contre les bourreaux nazis, y compris la déposition d’une survivante miraculeuse du massacre de Baby Iar, mais ne mentionne pas l’occultation systématique du génocide juif en URSS. Or, le régime stalinien, tout en libérant l’Europe du joug nazi, non seulement remplaça celui-là par le joug communiste en Europe centrale, mais continua de facto la destruction de la judéité. Il ne faut pas oublier qu’après l’holocauste, il ne resta en Europe qu’un seul endroit où il y avait encore une haute concentration de porteurs de la culture juive traditionnelle, l’URSS. Or, à cause de la politique « culturelle » de Staline, cette culture ashkenaze millénaire cessa d’être. Il suffit de se souvenir comment, dès le début de la campagne contre le « cosmopolitisme », Ilya Ehrenbourg, homme de confiance de Staline, toujours chargé de missions « délicates », expliquait à ses amis « progressistes » occidentaux que les Juifs soviétiques n’avaient point besoin d’une culture en yiddish : ils ne voulaient que s’assimiler, se fondre dans la masse soviétique et s’exprimer en russe[15].
Mais comment osé-je comparer Hitler, celui qui conçut la « solution finale », et Staline, celui qui débarrassa l’humanité de ce monstre ? De ce point de vue, il est très instructif de voir le film récent d’Andrzej Wajda, « Katyn », qui reconstitue l’histoire du dépeçage de la Pologne, en septembre 1939, entre les nazis et les Soviétiques, et surtout, celle du massacre de plus de 20 000 officiers polonais faits prisonniers de guerre par les Soviétiques[16]. Le vieux réalisateur (dont le père était l’un de ces officiers) y met en parallèle les agissements des nazis et des Soviétiques. Ainsi, une scène poignante montre l’entente cordiale qui régnait entre la Gestapo et le NKVD réglant ensemble des questions administratives. Et pendant que les officiers polonais, élite de la nation (car parmi eux, la plupart étaient des réservistes : ingénieurs, scientifiques, médecins, écrivains, et non des militaires professionnels), roulaient à l’Est dans des wagons pour le bétail, pour être massacrés en avril 1940, les nazis arrêtèrent l’élite scientifique de Cracovie pour l’envoyer dans des camps de concentration dont peu sont revenus. Wajda montre également le travail de propagande nazie et soviétique : dans leurs documentaires respectifs, les deux régimes utilisent les mêmes mots et les mêmes clichés pour faire porter la responsabilité du massacre de Katyn à la partie adverse.
Le film de Wajda se termine par une scène insoutenable : les officiers amenés dans la forêt de Katyn y sont exécutés à la chaîne, avec des gestes bien précis, par des membres du NKVD. Les tranchées ayant été creusées à l’avance, on fait descendre chaque nouvelle victime du fourgon, deux NKVDistes la serrent pour empêcher toute tentative de fuite et le troisième lui tire une balle dans la nuque, après quoi le corps sans vie est poussé dans la tranchée.
Comme la sortie de « Katyn » sur les écrans français a coïncidé peu ou prou avec la diffusion de « Einsatzgruppen : les commandos de la mort », on ne peut s’empêcher de comparer les techniques d’extermination de masse chez les nazis et les Soviétiques. Les nazis étaient peut-être plus sadiques, car ils forçaient souvent leurs victimes à creuser eux-mêmes les tranchées où elles seraient exécutées et avaient recours à des pratiques humiliantes, comme l’ordre systématique donné aux victimes de se déshabiller avant d’être fusillées. Apparemment, les concepteurs de ce mode d’extermination voyaient la nécessité de déshumaniser les victimes pour faciliter la tache des bourreaux. Quant aux NKVDistes, ils agissaient avec plus de « retenue » : les victimes ne savaient pas, jusqu’au dernier instant, qu’elles allaient y passer, et elles étaient abattues individuellement, ce qui ne changeait en rien le caractère industriel de ce meurtre de masse. Par contre, dans l’application de la torture, la Tchéka sous ses différentes appellations (comme le NKVD ou le MGB) ne cédait en rien à la Gestapo[17].
Bien naturellement, le massacre de Katyn, qui n’est qu’un épisode dans la longue série de crimes de masse du régime soviétique, s’inscrit dans la continuation de la logique de la Grande Terreur de 1937-1938. Mais contre qui, au fond, fut dirigée cette Grande Terreur qui emporta, en seize mois, 750 000 vies humaines et envoya un nombre similaire de personnes au Goulag ?
Comme le montre, à l’appui de documents extraordinaires, Nicolas Werth dans son dernier ouvrage, Staline était résolu d’ « apurer » le peuple soviétique. Craignant l’apparition d’une « cinquième colonne » en cas de guerre avec l’Allemagne nazie, il entreprit un gigantesque exercice d’eugénisme social afin de débarrasser la nation des traîtres potentiels. Or, parmi ces « traîtres » se retrouvèrent non seulement des catégories entières de la population soviétique perçues comme « peu sûres » (anciens officiers ou fonctionnaires tsaristes, anciens membres de partis révolutionnaires autres que les bolcheviks, le clergé, les anciens « koulaks », etc.), mais aussi des groupes ethniques jugés « suspects » : les Polonais, les Lettons, les Allemands, les Finlandais, les Chinois, les Roumains et quelques autres. Le total des exécutés dans le cadre des opérations dites « nationales » était de 247157 personnes dont 111000 Polonais[18].
En fait, les opérations « nationales » lors de la Grande Terreur sont un maillon important de la politique nationale stalinienne : la famine génocidaire en Ukraine qui visait majoritairement la paysannerie ukrainienne réticente à la collectivisation (1932-1933) ; les opérations « nationales » pendant la Grande Terreur (1937-1938) ; les opérations massives d’« épuration » dans les territoires annexés de l’Europe de l’Est (1939-1940 ; 1944 – début des années 1950) ; les déportations génocidaires des peuples entiers – Coréens, Allemands, Finlandais, Karatchaï, Kalmouks, Tchétchènes, Ingouches, Balkars, Tatars de Crimée et Turks Meskhètes – pendant la Seconde Guerre mondiale ; enfin, la campagne antisémite (1948-1953) qui laissait présager le pire pour les Juifs soviétiques. Ces campagnes d’extermination selon le principe national se sont soldées par la mort de 7 à 8 millions de personnes, ce à quoi s’ajoutent quelques millions des victimes d’extermination au nom de la lutte des classes[19]. Une question s’impose : en quoi ces génocides perpétrés par Staline sont-ils différents de la Shoah ? N’est-ce le même désir d’éradiquer la « vermine » qui empêche la construction d’un avenir radieux : le Reich millénaire ou le communisme.
Si Hannah Arendt fut la première à introduire le concept du totalitarisme qu’elle appliqua aux deux régimes du XXe siècle – hitlérien et stalinien, c’est l’écrivain Vassili Grossman qui, avec la lucidité digne d’un prophète, mit face à face ces deux régimes – camps de la mort hitlériens et camps de concentration soviétiques – dans son roman « Vie et Destin ». Il acheva cette fresque majeure de la vie soviétique et de la Seconde Guerre mondiale en hiver 1960, mais le manuscrit fut confisqué par le KGB. Selon l’idéologue en chef du parti communiste, Mikhaïl Souslov, ce livre nuisible à l’idéologie communiste ne pouvait être publié « avant deux ou trois cents ans ». Mais comme Souslov était loin d’être un prophète, le roman parut en 1980 en Occident (un ami de Grossman en a gardé une copie) et fut publié en URSS en 1988, en pleine perestroïka[20].
Hélas ! L’époque gorbatchévienne et les premières années eltsiniennes étaient bien plus ouvertes et honnêtes intellectuellement que la société russe d’aujourd’hui. Il y a vingt ans, on ouvrait les archives, de nos jours, elles sont de nouveau fermées. Il y a vingt ans, le massacre de Katyn fut officiellement reconnu, aujourd’hui, malgré les documents du NKVD déclassifiés et publiés en 1992, ce massacre est de nouveau passé sous silence, voire attribué de nouveau aux nazis, comme à l’époque stalinienne. De nos jours, on glorifie de nouveau Staline en Russie, car il a non seulement gagné la Seconde Guerre mondiale, mais a élargi les frontières de l’URSS au-delà même de celles de l’Empire tsariste. On ne parle plus en termes d’idéologie communiste, mais en termes de la puissance russe millénaire[21]. Par décret du président « progressiste » Dimitri Medvedev, on a constitué même une commission spéciale chargée de veiller à toute tentative de réécriture de l’histoire. Formellement, il s’agit de contrer toute tentative de mettre en doute la victoire de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale, qui devient un délit passible de prison. En réalité, ce sont les révisionnistes au pouvoir, avec Medvedev et Poutine en tête, qui essaient de rendre criminel tout regard honnête et lucide sur le passé soviétique, et en particulier, sur la figure et le rôle de Staline[22].
Je reviens à ma question : comment mettre sur le même plan Hitler et Staline, un monstre et son vainqueur ? Mon conseil : relisez « Vie et Destin ». Vassili Grossman montre admirablement que pour les soldats et officiers soviétiques, la lutte contre le nazisme était en même temps un combat pour la liberté dans leur propre pays : confrontés au danger de la mort, ils vivaient une libération intérieure. Le peuple soviétique a gagné la guerre non pas grâce à Staline dont les directives désastreuses provoquèrent la mort inutile de millions de militaires et civils, mais parce qu’il défendait son sol contre la barbarie nazie, dans un élan libératoire[23]. Quel dommage que MM. Poutine et Medvedev essaient de mettre à nouveau une chape de plomb au-dessus de leur pays à peine sorti du communisme.
[1] Voir l’étude exhaustive de Guennadi Kostyrtchenko, Politique secrète de Staline. Le pouvoir et l’antisémitisme (en russe), Moscou, Mejdounarodnyïe otnocheniïa, 2003, pp. 222-229.
[2] Pour l’histoire du Comité Antifasciste Juif, voir en particulier Alexandre Bortchagovski, L’holocauste inachevé, Paris, J-C. Lattès, 1995.
[3] Voir Kostyrtchenko, op. cit., pp. 196-222.
[4] Cité par Henri Picker, dans Hitler, cet inconnu, Presses de la Cité, 1969
[5] A la fin de la guerre, le CAJ était perçu par la population juive soviétique comme une sorte d’autorité juive. En 1952, la plupart des membres du CAJ furent fusillés après un procès à huis clos.
[6] Voir Guennadi Kostyrtchenko, op. cit., pp. 353-361.
[7] L’Ukraine occidentale (des territoires qui faisaient partie de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie), la Biélorussie occidentale (qui faisait partie de la Pologne) et les pays Baltes (indépendants entre les deux guerres mondiales) furent annexés par l’URSS en 1939-1940, en vertu des clauses secrètes du Pacte germano-soviétique qui prévoyaient le partage de l’Europe de l’Est entre l’Allemagne nazie et l’URSS. Dès juin 1941, ces territoires furent envahis par les troupes allemandes, puis réoccupés par l’armée Rouge qui chassa les nazis, en 1944.
[8] Déjà en 1939, Staline souhaitait démentir le cliché de la propagande nazie sur l’URSS comme un « royaume judéo-communiste », cf. Kostyrtchenko, op.cit. p. 199.
[9] Pour cette période, voir en particulier Guennadi Kostyrtchenko, Prisonniers du pharaon rouge, Solin, 1999 ; Jonathan Brent et Vladimir Naoumov, Stalin’s last crime : The Plot of the Jewish Doctors, 1948-1953, Londres, Harper Collins, 2003.
[10] Sur cet aspect, voir en particulier Laurent Rucker, Staline, Israël et les Juifs, PUF, 2001.
[11] Voir idem et aussi Kostyrtchenko, op. cit.
[12] Il n’existe pas de preuve directe pour l’existence d’un projet de déportation juive massive, malgré des rumeurs persistantes aussi bien parmi les Juifs soviétiques qu’en Occident dans les dernières années de la vie de Staline. Kostyrtchenko explique que ce projet n’aurait pu se réaliser qu’après une longue préparation qui n’était pas encore achevée au moment de la mort du dictateur (op.cit. pp. 671-685). Cependant, Arcadi Vaksberg, en se basant sur des témoignages concordants, démontre que la déportation a bel et bien été planifiée. Cf. son livre Staline et les Juifs, Paris, Robert Laffont, 2003, pp. 240-257.
[13] Baby Iar est une localité près de Kiev où près de 100 000 Juifs furent exterminés par des nazis en 1941. C’est le plus célèbre exemple de la « shoah par balles ».
[14] Une forteresse près de Kaunas, Lituanie, transformée par les nazis en un camp de concentration. Plusieurs dizaines de milliers de Juifs lituaniens et Juifs étrangers qui y avaient été transportés y furent fusillés en 1941-1942.
[15] Sur la personnalité complexe d’Ilya Ehrenbourg, voir Ewa Bérard, La Vie tumultueuse d’Ilya Ehrenbourg, Paris, Ramsay, 1991.
[16] Il s’agit du meurtre de masse de citoyens polonais (essentiellement, des officiers polonais emprisonnés), ordonné par le Politburo le 5 mars 1940 (résolution initiée par Lavrenti Beria et signée notamment par Staline). En 1942, le plus grand charnier a été découvert par les nazis près de Smolensk, dans la forêt de Katyn, mais ultérieurement, on a découvert d’autres charniers, et lors de la brève ouverture des archives dans les années 1990, on a aussi retrouvé des listes des assassinés. Traditionnellement, on désigne par le terme « masacre de Katyn », ou simplement « Katyn », l’ensemble de cette opération qui se solda par l’extermination de 21857 personnes.
[17] Le curieux lecteur trouvera des détails glaçant le sang, par exemple, dans le livre de Sergueï Melgounov, La Terreur rouge en Russie, 1918-1924, Paris, Editions des Syrtes, 2004 (pour la « Terreur Rouge » ) ; ou chez Nicolas Werth, L’ivrogne et la marchande de fleurs, Paris, Tallandier, 2009 (pour la Grande Terreur).
[18] Op. cit.
[19] Pour l’ensemble des crimes staliniens, voir Stéphane Courtois et alii, Le Livre noir du communisme, Paris, Robert Laffont, 1997
[20] Pour le parcours de Grossman, voir mon article « Vassili Grossman, un précurseur de la dissidence », dans le recueil Dissidences (sous la direction de Chantal Delsol, Michel Maslowski, Joanna Nowicki), Paris, PUF,2005.
[21] La représentante la plus « flambante » de cette idéologie est l’historienne Natalia Narotchnitskaïa. Voir son livre Que reste-t-il de notre victoire ? Russie-Occident : le malentendu. Paris, Éditions des Syrtes, 2008. Voir également l’entretien avec Natalia Narotchnitskaia dans « Politique Internationale », N°123, 2009.
[22] Voir mon article Le révisionnisme à la russe, dans « La Règle du Jeu », N°36, 2008.
[23] À cause de la gestion désastreuse et cruelle des opérations militaires, les pertes soviétiques font non moins de 22 000 000 de soldats et officiers (certains historiens parlent de 26-27 000 000 de victimes), alors que les pertes militaires allemandes sont de l’ordre de 4 000 000 de personnes dont 2 600 000 sur le front de l’Est. Voir Boris Sokolov, Comment calculer les pertes lors de la Seconde Guerre mondiale (en russe), dans : « Kontinent », N°128, 2006.